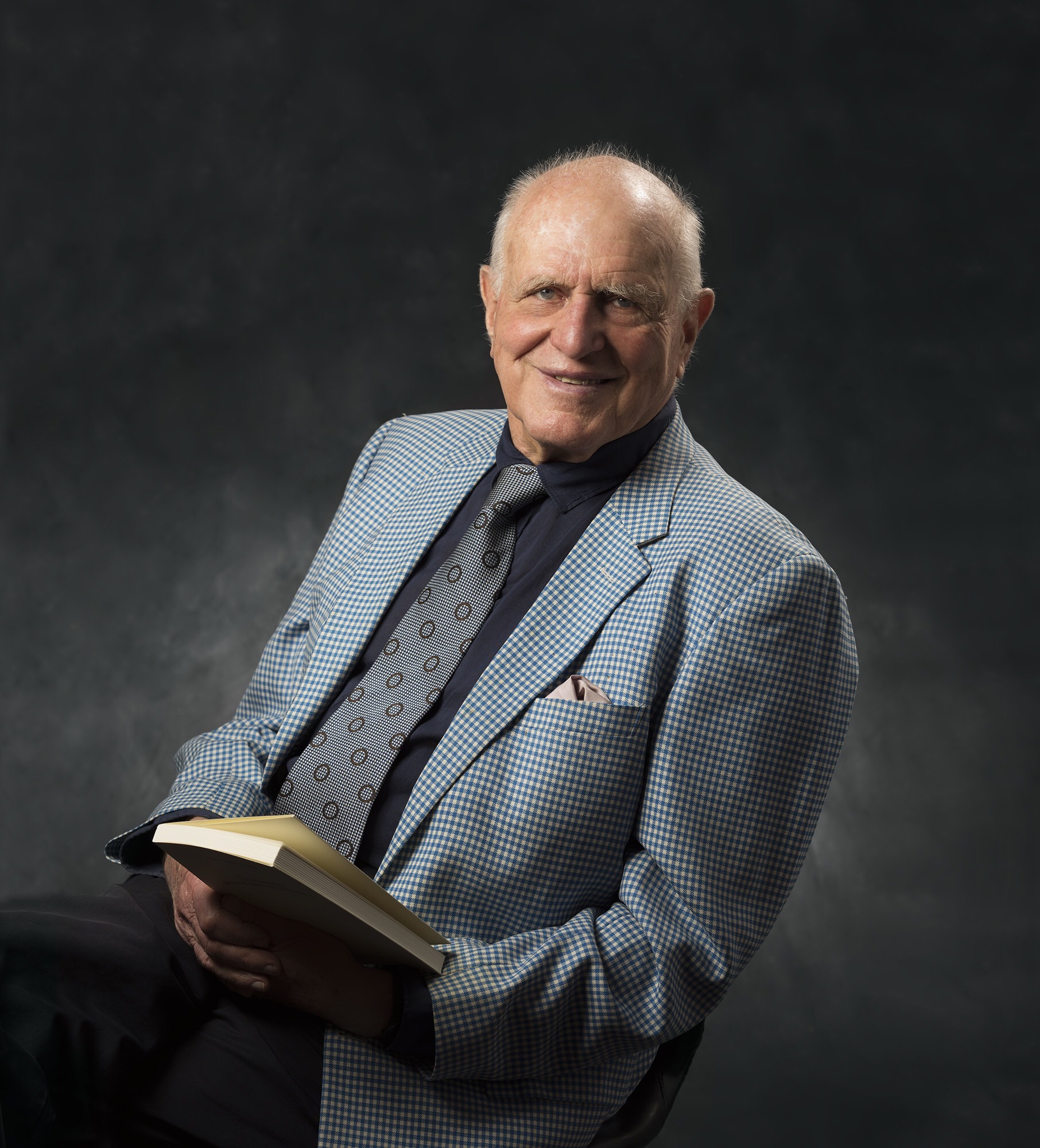Aventures d’un bibliothécaire (2)
Par Henri-Hugues Lejeune
Seconde Partie
À travers les siècles
Je me suis entendu dire, je crois que c’est une sorte de tradition orale, d’apologue, chez messieurs les écrivains, que Drieu La Rochelle en son temps avait la réputation d’un amant particulièrement souhaitable (ceux que l’on nomme « une bonne affaire ») pour être capable de longues étreintes, quasi une heure (disait-on autour de lui ou se vantait-il ?) avant de conclure l’assaut.
Il en signale quelque part un très vague jalon, relatant une anecdote. Très jeune il avait été racolé par une gourmande quasiment dans la rue. Il ne s’agissait pas d’une professionnelle, mais de quelque concupiscente et mûrissante « femme libre » comme il en est et en a toujours été ; il était fort beau et attachant, donc attirant.
Après l’avoir entraîné chez elle, elle lui dit : « Toi, tu n’as pas le tempérament que j’aurais cru, mais tu plairas aux femmes ».
Séquence dans l’évolution des mœurs, est-ce en ce sens que le goût et les prédilections évoluèrent au détriment de numérations arithmétiques parfois manifestement volontaristes pour ne pas dire vantardes et que l’on conçut et écrivit les romans avec un autre sens de la vie ou en connivence avec elle, à la suite peut-être de ce que furent, découvrirent, rêvèrent et apprirent à conter les Romantiques, qu’ils mirent en lumière -et peut-être que va, qu’évolue d’elle-même la littérature ? Ainsi approfondirait-elle peu à peu ce que nous connaissons de nous-mêmes : du moins est-ce une vision optimiste ?
Est-ce une invention, une vue de l’esprit ? Tant de choses sont survenues tandis que le temps passait, entraînant une complication généralisée de toute fonction mentale mal connue, mais ressentie, notamment de l’observation, de l’analyse et de la communication, comme une évolution psychique ? Il en pourrait ressortir que c’est davantage dans de telles directions que l’érotisme a dû diriger ses pas ?
D’où un développement de l’imaginaire, de la gamberge, de la rêverie plus ou moins unilatéraux, individualisés désormais… et du roman ! Chacun des participants d’une passion y éprouve quelque chose qui n’est jamais ni tout à fait commun ni ressenti ou partagé même dans la perfection ou l’harmonie absolue ou apparente.
Est-ce une hypothèse, une possibilité ? L’exotisme, de partout surgi, a pu y trouver lui aussi son compte, élargissant la perspective.
À ne considérer que la littérature, il semble bien qu’il en soit ainsi. Ce seront les Romantiques qui auront compliqué la vie à notre intention, épaissi encore la structure de ses matériaux, déjà surabondante. De quoi en effondrer toute la construction.
Décrire l’amour notamment. Ceux qui le font, le subissent, le dominent (plus rarement) le vivent enfin, ou imaginent le faire, l’inventent tout court ou croient en avoir le pouvoir ou celui de l’imaginer ou même d’improviser ou de décrire tout simplement. Qui est en vie, qui est en jeu, de l’être humain ou de la littérature, la question lui en est posée si l’homme peut espérer et part toujours en quête de quelque plénitude ?
Je me vois perdre pied au cœur d’un sentiment ou d’un spectacle étrange. Ma bibliothèque devant moi m’apporte une réponse : elle est le symbole de ce changement, le symptôme, la matérialisation de mon addiction, immodérée sans nul doute, à la littérature comme à mes propres complications.
Mes pérégrinations dans l’« Enfer », légères, bien légères, un effleurement pourtant m’avaient inquiété et déstabilisé, sonné l’alarme en quelque sorte. Je m’effrayais sans doute pour pas grand-chose, mais voici qu’à présent se pose sur nouveaux frais la question de savoir de quoi au juste la littérature est-elle, se retrouve-t-elle constituée, structurée, quel en est l’exact contenu ?
Quand on en parle de nos jours, il faut le dire, on songe tout de suite au roman dont elle est pétrie et qui l’écrase. Bien plus qu’auparavant : du coup en est-il le plus visible ?
À le considérer, il est devenu une mécanique étrange qui n’est pas littérature par lui-même à moins que son siècle ne l’y admette ou ne le revendique comme tel, parfois de guerre lasse on dirait. Il se présente aujourd’hui en ordre singulièrement dispersé : policier, d’aventures, d’anticipation ou de science-fiction, historique, populaire ou pas : celui – là fut un clivage important au XIXe, dès lors que les journaux se mirent à publier des feuilletons : il fallut Balzac pour le transcender: Eugène Sue n’avait pas suffi… En notre époque nous avons eu avec Simenon la même ambiguïté ?
Il y eut aussi l’idée, le concept qui trouva un vocable plus récent, d’« Intello ». Il fallut de nos jours inventer cette brillante appellation… ou cette complication pour le décrire ? Certes ces branches différentes de tout temps poussaient de l’avant leurs meilleurs créateurs de tout poil (policier, d’aventures, exotique, etc.) vers la littérature, dès lors que leur droit leur en était mis en cause ; Littérature donc qui s’avérerait ainsi une dévoratrice de temps, d’espace, d’existence, bruyante et « individualisée », mais ainsi innombrable.
L’histoire, les vénérables Mémoires (proliférantes, comme l’ego) les passionnants récits de voyage, la géographie même, la pensée où qu’elle se porte, les itinéraires spirituels, philosophie et sociologie se bousculent au portillon et nul ne saurait prétendre que la lecture de leurs grands représentants soit moins passionnante, moins littéraire ou enrichissante que le roman même… et le Théâtre et la Poésie ?
Le récit aussi, apparemment simple ou roman insidieux qui aimerait en prendre l’apparence et proclame ses droits haut et clair ?
Ainsi le roman serait-il bien l’apanage, la vitrine de l’imagination, si réaliste qu’il puisse se revendiquer d’être, Tolstoï pas moins que Balzac, sans parler de Flaubert ou de Dostoïevski voire de Dickens ou de Simenon, voire d’Agatha Christie.
Par qui, de quoi donc les romans sont-ils faits et pourquoi ?
La littérature sera présente par surcroît si l’on veut d’elle à tout prix, mais aux romans serait confiée, incombe la responsabilité de ce que pensent, font et rêvent les hommes, leurs contemporains de fait au moment où ils les lisent et que s’exerce sur eux leur emprise, bien que souvent ils croient, ou le prétendent, qu’ils leur racontent des histoires, vraies ou inventées, et que par ailleurs les sciences, le progrès, le temps qui passe et se déroule, le monde qui change les façonnent et les métamorphosent peu à peu en eux-mêmes.
Longtemps, un peu partout, toujours l’on a aussi raconté au bon peuple des voyages dans des pays imaginaires. C’était un prolégomène intangible que l’on ne demandait à personne de croire, mais qui présentait l’énorme avantage de pouvoir relater tout ce qui vous passait par la tête, une mise entre parenthèses mentale.
Les Anglais, éternels voyageurs, originaux et habitués à en faire à leur guise se sont distingués dans le genre, mêlant habilement la vraisemblance (je ne dis pas la réalité) à la fiction. Moins gens de lettres que nous peut-être, mais dont chacun sait qu’ils sont des esprits pratiques, ils se mirent à raconter la vie de gens qu’ils imaginaient ou interprétaient, les mêlant volontiers à leurs croisières ou leurs péripéties. Un roman, peu ou prou, c’est aussi ce que pourrait raconter de son périple un voyageur de l’imagination comme de la géographie.
Les Français plus rigoureux de nature se rallièrent peu à peu à l’idée de cette souplesse sans vraiment vouloir le dire, eux qui avaient rencontré des triomphes dans tout le reste, mais s’étaient contentés de quelques chefs-d’œuvre d’imagination un peu épars : ils n’étaient pas romanciers de naissance, mais descripteurs, analystes et narrateurs incomparables.
La littérature s’offre au lecteur, le roman entend s’imposer à lui.
Tout imbu de soi-même, suffisant et sûr de lui, si désuet peut-être qu’il pût paraître aux yeux de ses jeunes lecteurs du Monde que nous étions, Émile Henriot (toujours lui) ne manquait certes ni d’intelligence ni de malice : à propos de Laclos, cet homme « ambitieux et supérieur auteur d’un seul livre » si marquant qu’il renonça à en produire un autre, il avait glissé ailleurs, citant un ouvrage « plus destiné à frapper d’un grand coup l’opinion que représentant une manifestation nouvelle de cette intense nécessité d’écrire que les écrivains professionnels embellissent du noble terme d’inspiration ». En effet, quand il avait conçu et monté « Les Liaisons dangereuses » un succès en ce genre pouvait vous asseoir dans le monde. Littéraire ou pas il n’y avait encore que peu de carrières « d’hommes de Lettres », mais il commençait à y en avoir de par le scandale. Hier encore pour les pensionner à son aise, le Roi avait recruté Racine et Boileau en tant qu’historiens…
Ils se mirent néanmoins : ils étaient gens sérieux et sans doute la vision, l’idée, la notion d’alors sur l’histoire n’était-elle pas identique à la nôtre, ni de pure science mâtinée d’objectivité pure. Racine notamment amassa des documents puis rédigea. Ill se fit même reporter en accompagnant le souverain au siège de Namur, qu’il relate. C’est simple, fort détaillé même : le Roi a tout fait !
La scène a changé. L’auteur du XIXe siècle déjà et plus encore par la suite ne pourra plus guère se motiver d’une ambition autre que littéraire (sociale et financière à la rigueur à condition qu’il soit assez naïf pour l’espérer), à la notable exception des auteurs de mémoires ou de souvenirs toujours soucieux de se justifier ou d’espérer ne pas se laisser oublier. Devenus d’importants personnages, certains aussi se soucièrent de littérature, souvent d’œuvres théâtrales, pour corroborer leur notoriété : le Violon d’Ingres. Certains de ses grands auteurs se mêleront parfois d’histoire, dans une vision ou une version qui leur en tient à cœur : Chateaubriand certes chez qui elle est toujours proche puis épique dans les « Mémoires ‘Outre-Tombe » voire Stendhal qui, sous le titre trompeur de Vie de Napoléon, après une introduction magnifique d’intelligence et de lucidité (ayant dû en rabattre sur son projet original) décrit ce qu’il n’entend pas faire puis fournit une relation qu’il justifie par sa longue période de présence à la « Cour » de Bonaparte général, consul puis empereur et les occasions qui furent les siennes de l’approcher personnellement. Nos grands écrivains sont gens toujours lucides.
Il faudra attendre encore un peu -mais pas longtemps- avant que leur tête ne se gonfle et qu’ils s’imaginent détenir le pouvoir d’éclairer la société voire la changer ou la faire évoluer sur elle-même : Rousseau avait déjà été dangereux à cet égard.
Avec ces mœurs nouvelles, dans cette lumière devenue plus crue, on se retrouve au cœur de la littérature, du roman en l’occurrence chaque jour plus prépondérant et omnipotent, face à une mécanique aussi nouvelle qu’étrange. Il ne se retrouve plus littérature ipso facto, s’en soucie de moins en moins, et puis faut-il encore que ses contemporains veuillent bien en admettre l’idée.
Ceci une fois posé, il peut s’en retrouver frustré, oublié, emporté par le temps écoulé plus vite même parfois qu’il n’y a été admis, qui a encore accéléré de nos jours et avale impitoyablement à peu près tout ce que le siècle a pu lui offrir, avec certainement nombre d’irréparables injustices, des oublis, des catastrophes et du fait tout simplement que le goût et la mode changent et oublient. « La mode, c’est ce qui se démode », dira Cocteau qui s’y connaissait.
C’est aussi, mais alors seulement que naquit vraiment et fit fortune cette idée de l’auteur maudit que Villon avait jadis laissée entrevoir et qui toujours hantait ses marges, à cette différence près que la société avait été jusqu’alors impitoyable à son égard avant d’en accueillir le concept non sans de multiples comédies et une profonde hypocrisie. Des honneurs, ils ont toujours savouré le principe
chaque science se faisant plus exacte et précise, la littérature pour suivre la mode se mit également à croire vraiment à son histoire. Sainte-Beuve allait jusqu’à faire considérer un critique comme quelqu’un de sérieux !
Alors ferions-nous confiance à notre immémoriale mémoire de mieux en mieux infaillible ?
&
& &
Son parcours
La littérature fit son apparition, en même temps à peu près que la langue française en ce temps assez vague, sans vraie date et en tout cas difficile à définir que l’on nomme le Moyen Âge, en résonance et à l’instar de l’Anglaise et l’Allemande d’ailleurs (pour simplifier : d’autres ont disparu ou même ont survécu à la marge). Elles prenaient naissance, non pas seulement de par leurs racines, mais au cœur d’amalgames de spirituel et de temporel passablement plus alchimiques que scientifiques fantasmagoriques et merveilleux, mystérieux de surcroît : il ne nous appartient visiblement pas de connaître scientifiquement cette histoire, son existence même en tant que telle aurait découlé de ce que l’on aurait pu en apprendre dans ces conservatoires que l’on nomme archives ou bibliothèques :il n’y eut rien de tel en Occident avant le XIVe siècle. Les archives, très dispersées, restent rarissimes : on sait que l’allemand comme le français existaient parce que l’on en a gardé « Les serments de Strasbourg » en 842 qui a pour le moins esquissé le destin de l’Europe, un point c’est tout.
Les monastères, les particuliers, les « pouvoirs publics » conservaient ce qu’ils voulaient bien, ou qu’ils pouvaient. En Italie la Papauté maintenait tant bien que mal les choses à l’intérieur du Latin et à l’instar de Rome plutôt que tenter de « vivre » un Moyen-Age, attendait, guettait une Renaissance de l’antiquité : Boccace c’est dès le XIVe siècle
La mémoire populaire, la tradition orale ou autres faisaient de leur côté leur office, elles furent capables, génératrices peut-être, de prouesses étonnantes et de véritables métamorphoses qui sans doute nous échapperont toujours si nous ne savions assez souligner leur rôle.
Entre les grandioses vestiges de l’Antiquité en voie d’irrémédiable ruine sans doute, mais omniprésentes, les lois et coutumes « barbares », les mœurs, les religions et les légendes, les contes et les farces, les chants et les lais, le fameux, le fabuleux Moyen Âge qui entre en scène dans les bagages de plus ou moins féroces envahisseurs se comporta comme il le put il faut l’avouer . D’étranges acteurs, ou bien inattendus, nouveaux venus ou très anciens, apparaissent ou ressuscitent, les Bardes par exemple et leurs audiences. Au même emplacement social qu’à l’intérieur des hautes civilisations antiques.
L’inspiration, le souffle, la civilisation réelle, substantielle imposée parmi les nécessités d’alors se substitue à l’Antiquité qui avait éteint ses feux, à sa Bibliothèque devenue hélas si lacunaire, à son esprit, son inspiration ; mais son essence a su ou pu, en tout cas a réussi à se perpétrer jusqu’à nous, nous révélant par-là notre immanence, celle de l’Homme parvenant, par quelque tour de passe-passe, à un enjambement par-dessus son histoire de ce qui est, et demeure notre passé : ce Moyen Âge donc : une civilisation neuve, mais qui ne se présente guère comme telle, entièrement acharnée à son être, son vouloir, sa dangereuse existence, la dure nécessité de survivre.
La chute, par paliers successifs, avec nombre de soubresauts, de l’Empire romain d’abord, d’Occident ensuite, après le surprenant intermède de l’emprise sicilienne de Byzance sur l’Italie du Sud et Ravenne, sera remplacée sur son espace par une société diversifiée, progressivement germanisée tout au long de cette période transitoire qui se transfère peu à peu en Etat féodal.
Ce centre du monde chrétien s’est déplacé vers le Nord, par nécessité peut-être ; la conquête par l’Islam de l’Afrique du Nord puis de la Péninsule ibérique, refermant surtout vers le Sud la tenaille et la pression sur cette marmite en ébullition : l’Europe d’alors ; le littoral méditerranéen a perdu de son éclat.
Les Celtes jadis, dès avant l’Empire romain, avaient été vaguement soumis, intégrés au moins, Rome crut peut-être ou en fit semblant qu’il en serait toujours de même. Celtes ou Gaulois ? Les mêmes nous dit-on aujourd’hui, les uns vus depuis le Latin (Gaulois) ou le Grec ? Le savaient-ils bien eux aussi ?
Les Slaves, envahisseurs venus du Nord à la suite des Goths, se convertissent.
À la fin du Moyen Âge les deux églises chrétiennes, la Latine et la Grecque, seront confinées à une Europe quelque peu réduite et sous pression (sauf les enclaves copte et abyssinienne qui resteront dorénavant isolées, mais là où elles se trouvaient elles ont su maintenir leur emprise : il s’agissait, est-ce un hasard, de pays sans littérature trop active, aux frontières géographiques contraignantes).
Les nomades auront longuement dévasté l’Europe, miné au sud la prospérité de l’Islam, empêché ou retardé le développement de la Russie, mais tant bien que mal la sédentarisation aura prévalu : ils auront perdu la partie (les Cosaques deviendront exception, les Czars les prenant sous leurs ailes, mais les Tziganes seront exclus !).
C’est dans ce cadre que le ferment germain aura permis au « limes » de se métamorphoser. Il s’agit d’un phénomène inouï de l’aventure humaine : des trois civilisations sédentaires d’alors reconnues à l’espèce humaine, l’Empire romain, l’Inde et la Chine, ces deux dernières, faute de cette mutation chimique, auront certainement connu une sorte de stagnation morphologique dans laquelle elles retombaient après chaque commotion démographique, sans doute du fait de leur masse même, plus considérable alors. Nous n’en savons pas encore assez, mais bientôt nous faudra-t-il joindre à cette nomenclature les civilisations américaines actuellement connues sous le nom de Mayas ?
Métamorphose, car de nouvelles vérités s’en vinrent tout de go remplacer les anciennes : Rome avait bel et bien donné tout ce qu’elle avait à donner.
Sa culture, sa (ses) philosophie et sa pensée mûrissaient toujours, vieillissaient surtout tout autour de la Méditerranée et bien plus loin, mais elles manqueraient dorénavant de vitalité. Les talents ne florissaient plus, seules quelques personnalités émergeaient, souvent vagabondes : la culture est devenue polycentrique, ainsi les talents s’exportent ; l’impérialisme se débande Une notable exception est donnée par ces prodigieux historiens qui se penchent sur le passé avec nostalgie et nous permettront d’espérer pouvoir le comprendre et nous en imprégner et les premiers penseurs et philosophes du catholicisme qui veulent théoriser leur foi tels le Platonicien Plotin qui s’en vint enseigner à Rome ou Saint-Augustin revenu exercer son apostolat en Afrique du Nord.
Que constate -t-on au cœur de ce passé quasi fabuleux, car nous ne pouvons guère en appréhender le détail, l’exercice autant qu’il est réel, que voyons-nous tout soudain surgir : le roman tout armé dans la pleine splendeur d’une aurore, sa renaissance en quelque sorte, en une morphologie, une incarnation de ses propres légendes, de son histoire et de traditions dont le moins que l’on en puisse dire est qu’elles sont révolutionnaires.
Inédite démarche ? Ou celle-là même de la Haute-Antiquité légendaire et épique qui déboucha sur Homère puis cette civilisation prodigieuse « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » qui sut se faire classique ? Les cultures ont une vie, une naissance, une jeunesse, un épanouissement, un déclin. Spengler trouva les mots pour le dire (le déclin de l’Occident). Comment, dans quel ordre ? Toujours est-il qu’il se réinventa !
Nous allons nous trouver en présence d’une civilisation nouvelle avec armes et bagages, d’une « culture » absolument novatrice, située en de vastes espaces concrets et maints univers imaginaires. Quand un « héros » s’embarque, qui sait où il abordera.
Bien sûr l’espace est-il voué à s’occuper, les villes à prospérer, les Royaumes fabuleux à se colleter avec la réalité, à s’enfoncer dans le concret, l’Aventure à se métamorphoser en Histoire.
Cette implantation d’origine imaginaire est ainsi une carte d’identité d’origine.
Elle complique et éclaire à la fois la vision qu’il nous est possible de réaliser de cette invasion culturelle qui s’est avérée fondatrice de la nôtre.
Une partie non négligeable de la culture » arthurienne et médiévale ne s’engendrait-elle pas dans l’imaginaire d’un chef de bande de Pillards qui « imaginait » la proie dont il entendait s’emparer et qui rêvait de l’usage qu’il en pourrait faire ?
Sans le moindre doute, l’aspect guerrier et féérique, moral et social, les légendes et la fantasmagorie ambiante propres à cette période, la doctrine et maints composants : idées, traditions, pratiques, conceptions se sont incorporées au christianisme ou à ce qu’il était devenu de leur fait au cours des siècles résultèrent de l’apport des envahisseurs. Son culte si original des héros aussi.
Un nom vient immédiatement à l’esprit : les Celtes.
Qui sont-ils ? Un « groupe de peuples parlant une langue indo-européenne ? Individualisés vers le IIe millénaire, mais existant et déjà actifs auparavant ? Leur habitat primitif est sans doute le sud-ouest de l’Allemagne ? d’où ils furent refoulés ? Vers la Gaule, l’Espagne, dans les îles britanniques, dans la vallée du Pô pour être enfin soumis par les Romains (IIe siècle av. J.-C., Ier siècle après. C’est en Bretagne, dans le Pays de Galles et en Irlande que le type et la langue celtiques se sont le mieux conservés. » Admirable définition du Larousse : réponse en -au moins quatre ou cinq questions dignes de l’Oracle de Delphes dont le mieux qu’il y a à faire est de l’instiller telle quelle dans nos déambulations ! Cette perpétuelle et douloureuse errance, ces vicissitudes, ces situations souvent changeantes et souvent inédites et contraignantes n’incitent-elles pas à un certain lyrisme romantique et une conscience aiguë et malheureuse de tous les aléas de l’existence. Ils en auront été au moins un ferment puissant. Et s’ils en furent des acteurs importants ils furent loin d’être les seuls à avoir accompli cette révolution : le Moyen-Age ?
Celui-là se présente, s’impose à nous. Indéniable, irréductible, irrationnel aussi. Où va-t-il s’incarner ? Quand ? Prendre corps ? La littérature, renaître.
Le Moyen-Âge
Les Romans de Chevalerie, le merveilleux cycle de La Table ronde, l’Epopée de la Chanson de Roland, Tristan et Yseut, les Lais de tout genre étaient et demeurent peu attendus et tant soit peu improbables si l’on se réfère à l’unique bagage de l’Antiquité.
Tout ou à peu près de ce qui, du Moyen Âge est création et invention a pour théâtre essentiel un Imaginaire qui se crée sans cesse et ne se pose nulle part, une toujours insaisissable Bretagne ou bien ce royaume de Logres où le rêve moyenâgeux aimerait situer l’Angleterre qui figurent un univers, un espace, une sorte de Troie jadis aussi insituable que Homère lui-même pour la géographie, mais jamais pour les châteaux isolés enchantés à l’envie pour l’imagination; et de surcroît ces forêts et ce bestiaire fabuleux, fantasmagoriques aussi changeants que peuvent l’être les villes, les mers et les ports, qui sont à la fois et n’existent pas, de même les Royaumes évoqués ou bien ces monstres et ces dragons et dragons aussi improbables qu’ils sont nécessaires à leur narration comme encore les créatures féériques ou les magiciens eux-mêmes. Voire les ermites souvent dépositaires ou gardiens de traditions fabuleuses. Viendraient-ils d’un peu partout de sorte à traduire le souvenir, le gisement peut-être pas si perdu dans l’atavisme humain qu’on pourrait le croire des animaux fabuleux de la préhistoire bien avant l’espèce humaine proprement dite peut-être et puis les créatures féériques ou les magiciens nécessaires pour mettre en action tout ce beau monde. Mythes celtes aussi évanouis jadis avant même de pouvoir se mettre en place ?
Curieusement, dès qu’il y a roman, l’irréel surgit. Le récit s’y ancre, s’articule sur des lieux inventés ou bien réels fantastiquement utilisés au sein même de sa trame avant de s’en retourner vers les contrées du songe. Du coup le roman est d’ores et déjà maître et souverain, et le romanesque.
Si le Moyen Âge implante son cadre favori dans cet Occident de l’Europe cette délocalisation systématique est bien là pour spécifier aussi, quelque part clamer sans le dire nommément que cet univers ne relève pas, ne ressort pas ou plus du sol romain ou, in fine, de son essence et de sa culture : l’Antiquité éloignée, écartée, devenue païenne et dorénavant stérile.
Quel n’en est pas à nos yeux le fabuleux portique, ces cinq romans de Chrétien de Troyes en vers octosyllabiques à rime plate si beaux, entraînants et précis, malheureusement illisible sur la durée pour l’impatience surtout d’un Français contemporain, lors même qu’il pourrait à peu près les comprendre ! Dans une reconstruction historique de l’imaginaire, la Chanson de Roland pourrait convenablement prendre figure d’épopée homérique un peu appauvrie et privée d’élan de par la décadence des Empires et des royaumes qui les comportaient et qui avaient alors tourné court et passés de mode devenus simple part de la « culture » de l’époque.
La longue et glorieuse histoire de la littérature française présente la singularité de se situer bien souvent, et ceci de manière prépondérante en ses périodes « classiques » éprises d’analyse et d’exactitude, hors et bien souvent en opposition de ce que pourrait être un roman.
Or c’est bien lui qui se dresse maintenant de toute part, en triomphateur, dans un cadre d’ores et déjà bien précisé et établi, parfaitement étudié et balancé dans la grâce naïve et la fraîcheur qui sont sa marque spontanée, semblerait-il ainsi qu’il se doit en ces aurores.
Si j’en cherche à tout prix la source, je vois ça et là s’agiter des ombres, des évènements, des épisodes qui s’inscrivent dans le paysage en un mot dans la séquelle des cultures classiques qui ont constamment nourri l’esprit et le cœur de ceux de nos ancêtres qui avaient été en mesure de reprendre le flambeau de la main des anciens. Sans bien entendu omettre au long cours de ces mêmes siècles et de leur histoire, de leur sensibilité et de leur pensée, la consommation puis l’épuisement de récits et de rêves que le temps a inlassablement fait naître aussi bien qu’il les a laissés périr projetant dans un nécessaire oubli la plus grande part de cette nourriture d’imaginaire qui avait fait vivre et créer nos ancêtres et dont nous prenons aujourd’hui la part qui peut rester la nôtre.
S’il n’y eût plus, depuis l’Antiquité justement, et avant une période relativement récente, de bibliothèque ou de « lieu de mémoire » officielle signalés, sinon celles des monastères, de quelques souverains et seigneurs peut-être et de leurs cours dont le hasard et la chance autant que l’érudition nous auront suscités et conservés des trésors, comment voir et à plus forte raison éprouver ce qu’il a pu se passer au juste dans l’esprit des hommes, ni de ceux-ci ce qu’ils virent et vécurent en leur temps pour se retrouver un beau jour dans les arrière-plans lointains de la rencontre plus ou moins apaisée des astreintes de la guerre, de la structure militaire, religieuse et poétique des Celtes où le roman courtois et chevaleresque fit son apparition, succédant ou prenant la place de la chanson de geste avec en parallèle ce qu’il lui revient en propre de ces farces, contes et fables populaires de l’éternel humain.
Quel hiatus, quelle incertitude soit davantage encore d’interrogations au sujet d’une civilisation par ailleurs si agitée et surtout remplie et passionnante : la nôtre en son aurore. Fûmes-nous les seuls à comporter une mutation si soudaine ? Trois grandes civilisations dites statiques, géographiquement et historiquement stables et pérennes jalonnent l’histoire des hommes : l’Occidentale, la Moyenne-Orientale pour ne pas choisir entre le Proche-Orient de nos jours, Balkans, Perse et Indes davantage alors et la Chinoise, seule la nôtre, en toute apparence, supporta une opération « chirurgicale » de cette ampleur, connut de si brusques révolutions, aussi radicales, des évolutions si rapides et si intenses, aussi nettement dégagées que celle-ci de la gangue du simple état ? Quelle sorte de mise en question nous apporte-t-elle ?
Pourquoi et comment s’enrichit-elle soudain ? Des trois grandes civilisations dites statiques, géographiquement et historiquement stables et pérennes qui jalonnent l’histoire des hommes : l’Occidentale, la Moyenne-Orientale pour ne pas choisir entre le Proche-Orient de nos jours et les Balkans, incluant davantage alors la Perse et les Indes, et bien entendu l’intangible Chinoise, seule la nôtre, en toute apparence, connut de si brusques révolutions, aussi radicales, des évolutions si rapides et si intenses, aussi nettement dégagées de la gangue du simple temps qui s’écoule, la seule à changer de vitesse s’il faut user d’une métaphore. Et qui à ce titre métamorphosera le monde.
Cette construction vertigineuse est nôtre certes, mais en son âme et son histoire aussi que de cathédrales désaffectées, de citadelles oubliées sur des pitons délaissés, qui ne signifieraient, ne contrôleraient plus rien dans notre paysage ou notre psychisme.
Pourquoi, comment : au loin, à l’origine, se perçoit la greffe, sur le fond antique régénéré par les exégètes de la foi chrétienne qui sont venus renforcer et métamorphoser les structures de féodalité tribale errantes jusque-là des peuplades envahisseuses importées de l’est de l’Europe, voire d’un Orient moins lointain donc qu’on ne l’aurait éventuellement supposé. Les « envahisseurs » prenaient souvent leur temps pour se faire connaître comme tels. Il y avait, schématiquement, les gens à pied et les gens à cheval. Certains se déversaient comme un flot envahisseur, d’autres prenaient leur temps pour se révéler comme tels. Les deux ne se recoupaient pas strictement. Ce qu’il nous faut savoir et retenir : que notre Occident était leur Orient ! Dûment fantasmé et imaginé, du moins. L’Occident du coup avait eu du moins le pouvoir, le rayonnement réciproque de se voir désirer, voire convoiter, entretenant derechef le désir d’y prendre part, appelant, excitant la convoitise et provoquant l’invasion. Notre Orient était celui des autres : chacun a l’Orient qu’il peut. Dans ce tourbillon ses fondations n’avaient pu encore trouver jusqu’ici d’assise territoriale un peu permanente tandis que peu à peu s’inventait Venise, ce qui du moins montre qu’il était difficile de survivre sans s’interdire de bouger si l’on doit porter son nom de civilisation comme il advint malgré tant de difficultés pour quelques autres lieux quasi fabuleux élus par le hasard de l’histoire et la qualité des hommes comme Ravenne, Rome et Byzance qui se maintinrent tant bien que mal et surent à quelque moment s’imposer comme capitales ou centres incontournables et intangibles malgré les catastrophes vécues et endurées.
Telle était la dure loi pour tout un chacun, envahisseurs et envahis : survivre, se créer une identité, donner à leurs collectivités qui furent plusieurs et se combattirent longtemps en vue de se tailler un espace le meilleur le plus vaste et riche possible. Le pillard le plus virulent et souvent le plus sinistre ne se sent nullement gêné de s’installer le plus confortablement possible sur les lieux du crime, on nomme cela de nos jours du doux nom de sédentarisation ! Une ou deux générations gomment, lissent, institutionnalisent les situations acquises par la force : le catholicisme n’y obligeait-il pas ?
L’inéluctable brutalité de l’histoire n’y aurait pas suffi : la « civilisation « est perpétuelle » gestation.
Elles fusionnèrent aussi plus ou moins, lasses de se battre, ou (beaucoup, l’époque était brutale) périrent. Les occasions ne leur en manquaient pas. Il leur était indispensable pour réussir de trouver d’abord, de mettre en œuvre et mener à bien une, des structures nouvelles, une forme d’équilibre en somme originale D’en faire en un mot une société où devaient nécessairement trouver leur place ces populations soumises, mais enracinées dans leur terroir et imbues de leur prestigieuse histoire. Qui phagocyterait l’autre ? Logiquement les « autochtones » ?
Cela ne se fit certes pas sans de multiples conflits et au prix de batailles ou de massacres qui furent longtemps à se cicatriser, mais ce fut peut-être facilité par le fait que les peuplades et les espaces concernés étaient ou avaient été part d’un empire qui certes s’était estompé de plus en plus avant d’être submergé dans une Rome qui finit par être conquise, mais avait jusqu’au bout conservé ses administrations, ses élites, la plupart de ses structures et parfois ses armées. L’essentiel du travail s’effectua sans doute de l’intérieur.
L’espace envahi et ses peuplements avaient été trop denses par rapport au nombre d’envahisseurs aux yeux desquels il devait être aisé de faire miroiter le mode de vie et les bienfaits auxquels leur propre civilisation les avait fait accéder, tellement supérieurs à tout ce qu’ils avaient pu eux connaître. Le massacre et la servitude ne pouvaient tout résoudre. Ainsi bien plus tard les Chinois absorbèrent-ils les Mandchous et survécurent, tels qu’en eux-mêmes enfin…
L’alibi fourni comme les inlassables messages de tempérance, de fraternité et d’union d’un catholicisme en pleine et fraîche expansion qui était en voie de parachever sa propre prise de possession et d’établir sa hiérarchie fournirent sans nul doute un lubrifiant et un baume pour mettre en œuvre ces rouages puissants. Et ne fallait-il pas à un moment quelconque faire front commun de bon ou mal gré en face de menaces continuellement répétées de nouvelles invasions ?
Enfin les plus intelligents et évolués, les élites des conquérants comme des conquis ne se retrouvèrent-ils pas face à face au long tout de même de quelques siècles, bien peu si l’on considère la très longue histoire des hommes qui par parenthèse s’allonge singulièrement à mesure de la progression des sciences humaines modernes.
La nécessité mit en place avec une rapidité déconcertante société, vie culturelle, configuration économique, élites et mœurs nouvelles : la Féodalité. J’ignore quand et où ce vocable décisif prit place pour la décrire ? Il s’agit en tout état de cause de la fusion entre les systèmes germain et romain : Grosso Modo sur le fond administratif et la civilisation antique de Rome se greffa un apport germain qui généra et mit en place ce système féodal plus souple dans sa brutalité, d’homme à homme, de souverain à vassal quasiment instantané dans son instauration, qu’elle fut paisible ou douloureuse, dans une société aux rouages autrement paralysés.
La religion aura bien sûr assuré et rendu quelque part nécessaire ce triomphe en convertissant les Barbares assez avisés pour être soucieux d’asseoir leur pouvoir ; ils n’avaient pas dans leurs premières vagues apporté eux-mêmes de croyances religieuses de nature à s’imposer à toute force en terrain conquis comme auront pu le faire juste avant eux les Arabes en Afrique Méditerranéenne puis en Ibérie, renforçant la pression de la marmite qu’était devenu l’Empire romain d’Occident. Une religion n’a pas en permanence la virulence nécessaire pour massacrer ses adversaires : cela intervient detemps à autre, quasi impromptu parfois. Elle fut en mesure de conserver sa hiérarchie, ses dogmes, sa culture de fonder ses monastères et d’abriter ses savants déjà rodés et intégrés au sein même de l’Empire, d’insuffler et instaurer une épine dorsale à la société nouvelle.
Qu’étaient-elles au juste ces sociétés anciennes sur lesquelles se précipitaient des « hordes » de Barbares ? Il est ici question des « nomades » et des « sédentaires ». En fait des cultivateurs, agriculteurs liés à leurs terres et des peuples éleveurs de troupeaux qui erraient de place en place à la poursuite des pâturages. Certes ceux-ci étaient bien meilleurs combattants et soldats supérieurs tactiquement à l’ancienne légion romaine à présent dépassée, conquérants habitués à s’emparer par la force éventuellement des indispensables espaces, cavaliers batailleurs et pillards ataviques. S’ils apparaissaient en trombe, leur nombre réel était généralement bien inférieur à ce qu’il en paraissait aux paysans apeurés moins peut-être encore qu’aux populations urbaines qui constituaient bien malgré elles l’appât essentiel des envahisseurs. Ce qui tendrait à expliquer que l’« assimilation » fut plus rapide que l’on aurait pu le croire.
Il s’agit là tout simplement de l’immémoriale rivalité, si vivace encore en Afrique par exemple entre agriculteurs et nomades éleveurs de troupeaux, dévorateurs d’espaces.
Le système simple et fruste de la féodalité territoriale directement issue des structures nomades fut ainsi assez rapidement en mesure d’apporter aux royaumes éclos puis consolidés des élites nouvelles dans les antiques moules nouvellement ajustés en toutes leurs dimensions, peu nombreuses d’abord, mais vite de plus en plus affinées et influentes. Ce système simple et brutal, mais efficace et direct était de toute façon mieux adapté « physiquement » à cette « modernité » que le modèle impérial administratif et hiérarchisé devenu trop complexe et trop lourd à assumer, manquant sans doute d’élites assez nombreuses pour le desservir.
Mais les conquérants n’en avaient pas moins remporté la victoire politique et ils avaient amené avec eux leur imaginaire plus intense et fabuleux comme plus irréel et décousu, magique pourquoi pas que celui de leurs hôtes malgré eux : ils fournirent sans nul doute une large majorité des mythes, des thèmes et des songes qui hantèrent cette période inimitable ; n‘avaient-ils pas affaire, à l’intérieur du limes, à une civilisation romaine, antique, mais désenchantée et à bout d’elle-même, déjà travaillée par le catholicisme. Là ils furent aussi vainqueurs de par « l’Imaginaire » !
Dès la fin des « Douze Césars » la prodigieuse civilisation antique multiplie les signaux d’épuisement. Certes l’architecture achève de s’implanter dans tous ses pourtours ; l’administration fonctionne, son armée n’a pas encore de rivale, les Beaux-Arts, dont la sculpture, mais aussi la fresque comme l’architecture nous conservent quelques-unes de ces grandes pièces de mémoire produites pour l’admiration de ses sujets et si quelques-uns de ses plus grands historiens ne sont pas encore tous là, mais ils vont surgir pour retracer et éclairer la prodigieuse aventure de Rome. Mais la créativité littéraire, la poésie, l’esprit d’invention sont comme frappés d’anémie, d’une sorte de torpeur.
Il ne faut pas oublier que l’on a très vite affaire à deux empires romains, d’Occident et d’Orient comme à deux langues, le Latin et le Grec, que la géographie ne recoupe d’ailleurs pas exactement, soit une culture littéralement en morceaux… choisis. La symbiose s’oublie progressivement.
En Occident, Horace et Virgile ont suscité des suiveurs, mais pas de successeurs ni surtout d’émules.
Le « Satiricon » paraît bien seul de nos jours pour symboliser du roman l’énergie créatrice. « L’Âne d’Or » ne mène pas très loin l’âme inassouvie. Car seule ou à peu près la veine plus bigarrée, tapageuse d’Ovide s’adapte à une société plus blasée que créative, éveille quelques talents, ouvre des voies, imagine çà et là des modes plus libres, en un temps ou un autre, comme au hasard et à la fantaisie du talent et suscite ainsi à une civilisation devenue un peu languide quelques continuateurs dans les voies traditionnelles. Cette évolution paraît plus souple et aisée, sans la raideur quelque peu abrupte du génie.
En Syrie au IIe siècle, Lucien de Samosate, rhéteur de langue grecque, discoureur et conteur, esprit positif et caustique, incroyant de tout, parcourut l’Empire en donnant des sortes de conférences-spectacles pour se montrer et gagner (bien) sa vie, mais aussi rencontrer les grands esprits du temps. Il reprend les idées de métamorphoses, les voyages merveilleux d’Ovide, toutes sortes de récit ou de modules et en vue d’illustrer ses convictions cyniques, mais créatives et pleines d’humour et de solide bon sens. Il termine sa vie en grand dignitaire impérial. Au travers des siècles son scepticisme souriant et son humanisme désabusé évoquent Voltaire, mais il n’est pas Voltaire si peut-être Voltaire ne fut-il que Lucien. La morphologie inventive de ses écrits, très lus tout au long des siècles ultérieurs, influença nombre des auteurs qui lui succédèrent, la littérature poétique en décadence s’exilant alors dans les bergeries campagnardes ou le Petit Trianon comme à l’époque de Longus.
Témoins lucides de ce lent déclin, d’excellents historiens le déplorent, mais expliqueront lucidement à notre intention les grands ancêtres ou les archives du passé et les premiers penseurs chrétiens s’élancent : Plotin né en Égypte, mais qui enseigna à Rome tente la synthèse de Platon et de la pensée catholique, comme Saint-Augustin, évêque en Algérie.
Pour qu’une civilisation, et le système féodal en fût incontestablement une, puisse prendre place, encore faut-il que le tourbillon s’arrête, trouve quelque répit, que pour partie du moins certains foyers, certaines structures, pour ne pas dire des sociétés, ce qui serait certes un mot pour lors trop moderne puisse s’enraciner, évoluer proprio motu, mettre leur destinée en route, non sans avoir en quelque autre moment, douté d’elle-même, voire aussi utilisé la force pour s’établir et disposer dès lors de la pensée, du souffle et de l’inspiration pour le faire.
Toute cette région, enfin ce continent, car jamais l’Histoire n’a-t-elle osé mettre en doute la spécificité de l’Europe cet Occident à l’extrémité de son immense continent, a été au cours des siècles le réceptacle de la pérégrination des… nomades si toutefois ce mot peut s’appliquer en l’espèce, englobant des populations, des races entières, quasiment des variétés et des mutations de l’espèce humaine qui s’en venaient buter sur la barrière alors infranchissable de l’Océan Atlantique. Sa forme oblongue en faisait et en fera toujours un réceptacle obligé concentrant toutes les pressions ethniques.
La seule énumération des peuplements limitrophes du goulet européen est impressionnante. Si l’Empire avait phagocyté les Celtes qui eux-mêmes l’avaient plus ou moins conquis, ce qui est de la plus grande importance dans notre propos de par la métamorphose de l’imaginaire occidental générée par cette osmose, puis au moins tenté voire engagé d’apprivoiser leurs successeurs et partiellement réussi quant aux Germains, aux Francs ou aux Burgondes, la liste est impressionnante des voisins plus ou moins incommodes, mais aussi ambitieux et conquérants avides de trésors comme d’espace : en sus des Francs, Frisons, Marcomans, Alamans, Quades, Vandales, Gépides, les Wisigoths et les célèbres Ostrogoths les plus forts et les plus entreprenants de tous ceux des Germains qui faisaient monter la pression. Les Huns, les Slaves, se profilaient tout comme ces étranges, barbares et lointains Scandinaves qui, sous le nom de Vikings voire de Normands envahissaient dès l’époque carolingienne par terre ou par mer au moyen d’opérations-éclairs à travers toute l’Europe, qui se qualifiaient eux-mêmes aussi de Varègues, plus soucieux ceux-là d’abord de butins et de rapines voire de commerce si l’occasion s’en présentait que de peuplement, qui poussèrent jusque devant Constantinople tout autant qu’ils s’implantèrent en Normandie et en Grande-Bretagne surtout !
Et j’en passe : il importe de ne pas oublier la pression supplémentaire venue d’Afrique du fait de la conquête arabe, venant par la péninsule Ibérique et refermant la mâchoire de l’étau.
Au sein même de l’Empire décadent, dès la chute de l’Empire d’Occident, le système féodal se mettait en place un peu de lui-même en transformant la morphologie de la société ; les recherches récentes sur les Gaulois tendent à montrer une organisation sociale de grosses communautés rurales plus ou moins à l’écart les unes des autres qui n’en paraissent pas à cent lieues.
Quelque en fut le terrain préparatoire, bien des choses advinrent en tous sens pendant cette effusion de quelques trois grands siècles, si brève en histoire humaine. L’Europe entière était concernée tout comme le Proche-Orient et les Balkans.
Tout paraissait se multiplier, foisonner.
Repère dans ce tourbillon, en pleine expansion, l’Église Catholique avait vécu une vraie mutation, s’était organisée et matérialisée dans le cadre de l’Empire et de son modèle administratif, installait des évêques pourvus d’un district qui formaient des prêtres et prêtaient main-forte à l’instauration des monastères, les villes de paroissiens. Les Universités inspirées sans doute par les anciennes organisations de l’antiquité initiées par les philosophes et savants d’alors (c’étaient souvent les mêmes) qui y enseignaient leurs élèves et se retrouvaient en mesure de constituer de vrais ensembles organisés d’enseignement qui avaient acquis une renommée internationale. La perspective était maintenant différente : il était là question de proposer, de permettre la formation théologique des jeunes gens de condition plus moyenne pour former les cadres du clergé ou de l’administration urbaine ou seigneuriale. Le 3e concile de Latran en 1179 avait décidé que toute église cathédrale devait « entretenir un maître chargé d’instruire les Clercs de l’Église ; élargissant progressivement leur tissu, elles s’égrenèrent pendant tout le XIIIe siècle en s’étoffant autour de quatre Facultés principales, Arts libéraux, Droit Canon, Médecine et Théologie tout au long du XIIIe siècle. La plus ancienne fut créée à Bologne dès 1220. L’Université avait perçu la nécessité de se faire institution sociologique et presque d’emblée se réalisa d’elle-même dans son ampleur vraie ne se contentant plus de la « rhétorique » ancienne.
J’ai parlé des monastères qui avaient reconstitué des bibliothèques : mais les monastères en eux-mêmes étaient créations de relativement fraîche date ; les temps plus anciens, la littérature « courtoise » est claire à cet égard fait surtout mention d’ermites, qui parfois se regroupaient géographiquement peut-on dire, comme l’est aujourd’hui encore pour une grande part, le mont Athos et comme la montre volontiers l’iconographie orthodoxe dans ses arrière-plans paysagers. Il faut se souvenir que les vieux textes parlent de déserts peuplés d’ermites !
Ces monastères étaient dotés de relativement vastes domaines qu’ils exploitaient eux-mêmes ou organisaient sous leur direction ; leur statut les voulait autonomes et autosuffisants. Leur exploitation était rationnelle, génératrice de progrès, stabilisatrice d’espaces, plus bénigne sans doute dans sa gestion.
Il me faut parler de tout, car tout survint à la fois et partout : si je n’en rendais pas compte je ne suis plus en mesure de parler de rien, de comprendre ni apprécier surtout.
Il n’était pas tant, il n’était pas ou plus seulement de la seule théologie, de la méditation sur la Vie éternelle, sur l’essence ou la nature de Dieu, de son rapport avec son encombrante créature, de l’Univers en général (on ne parlait pas encore de Cosmos).
Mais il était fort question alors de théologie. Le « dogme » cherchait son chemin au travers de florissantes hérésies, se définissant et se découvrant lui-même à mesure. Tant d’éléments par ailleurs, d’évènements, débats, hérésies, voire schismes avaient, d’un peu partout, surgi, jailli dirait-on, que cela même signifiait quelque chose, la recherche d’un sens, d’un langage, d’incarnations, au sein d’obsessions nouvelles.
Il existait alors de saints hommes qui parfois erraient et devenaient hérétiques. Oui, mais qu’était l’hérésie, mais pourquoi et en quoi était-elle hérésie ? Ou pour qui et aux yeux de qui ?
Les Ariens avaient trouvé leurs successeurs.
Nombre de ces moines exaltés vivaient aimantés par le Très-Haut, en attente impatiente de « savourer Dieu » (Bernard de Clairvaux). La quête mystique est infinie et sans cesse renouvelée : « toujours rassasié toujours tu bois, car toujours il te plaît de boire ». Béatitude incessante, inquiète donc.
Quand l’hérésie pointe, le pseudo-Bernard de Clairvaux : « Pourquoi t’enorgueillir, poussière et cendre, toi dont la conception est une faute, la naissance un malheur, la vie une peine, la mort une angoisse… », les Vaudois, les célèbres et malheureux cathares, qui concernent davantage la France et les pays d’Oc surtout, ne sont pas loin.
Dans ce degré d’intensité partout ressentie, les monastères entendaient se saisir de tout en conservant leur autonomie aussi entassaient-ils dans leurs nouvelles installations, étendant leurs pseudopodes, créant leurs archives, facilitant et divulguant la circulation des œuvres des créateurs, y compris les Trouvères, qu’ils accueillaient comme tout un chacun, les dépêchant parfois vers leurs publics, les villes et les Cours, voire qui se recrutaient parfois, semble-t-il, dans leurs propres rangs.
Mais il ne me faut pas errer moi-même (sutor, ne supra crepidam…) : j’aime trop pour refuser de l’admettre cette idée que tout surgit d’une seule volée, que le rideau s’ouvrit sur cet incomparable embrasement que de me soucier d’aller plus loin et de fouiller plus profond comme les savants médiévistes en ont le devoir; ne suis-je pas déjà heureux d’avoir le plaisir de savourer leurs découvertes ! De mon côté je m’étonne et j’admire : un regard curieux présente du moins un avantage et ce charme certain de et leur déroulement s’émerveiller et être saisi et surpris. Certes l’historien comme l’érudit y ont bien aussi droit : ils ne se trouvent pas là par hasard, mais c’est à eux qu’il incombe d’aller au fond des choses, le pourquoi et le comment bref leur raison, car, quoique l’on en ait, l’histoire n’est jamais, en dernière analyse si naturelle que l’on veut le croire et l’espérer et spontanée et tout ne se passe pas de manière si logique qu’il peut le paraître, le malin génie en plus.
Iris n’est-elle pas dit le philosophe Fille de Thaumas ?
&
& &
Parcours
Dès le Moyen Âge, la littérature se trouvait donc en mesure de renaître : elle ne s’en priva pas, jaillit de toute part, fit flèche de tout bois.
Le haut savoir en mesure de la nourrir, le terme de culture se ferait trop vague pour définir toute cette créativité, n’avait pas disparu, mais il s’était passablement estompé au cours de ce long demi-millénaire, entre les mains de prestigieux, mais discrets relais, dans des havres de sécurité disséminés ; des gardiens de phare éminents persévéraient dans l’être çà et là dès qu’ils en avaient la possibilité, dans les temps d’accalmie, à l’écart des catastrophes.
Elle était ardemment souhaitée : très attendue, elle s’avéra soudain possible en face d’ un mode de vie nouveau qui cherche à s’instaurer au sein d’un monde difficile, belliqueux et dangereux. Nous ne saurions parler d’une civilisation encore, en aurons-nous ensuite le droit ?
Le moins que l’on puisse dire est que les avis en auront été partagés et le demeureront sans doute toujours ; l’on aurait fait hurler tous les lettrés de la Renaissance et des époques classiques, voire baroques, si on le leur avait suggéré.
La prudente dénomination de « Moyen Âge » apparaît au XVe siècle chez des humanistes italiens pour désigner la période entre Antiquité et Renaissance ; de fait ceux-là attendaient -et espéraient vivement- le retour de l’antiquité classique, rénovée bien sûr. L’appellation est reprise en Allemagne au XVIIe siècle puis en France. C’était alors la définition nettement péjorative d’un sombre intervalle, une véritable interruption. Il fallut les Romantiques pour le décrasser et lui conférer un lustre qui demeurera toujours ambigu et contesté : les rationalistes, les scientistes ne lui pardonneront de toute façon jamais son indéniable mysticisme.
En premier lieu du moins aurait-il été le domaine des plus austères des disciplines entre les mains des plus savants et retirés du siècle, de ceux en mesure de travailler en paix et transmettre le flambeau, des clercs en général, plutôt que de créateurs laïcs isolés. Que ce soient l’histoire, la philosophie, la médecine, ce qu’il existait de plus exact et abstrait dans les sciences. Ce savoir y constituera une sorte de mise en place, de réveil, d’appel.
Quel fracas idéologique, métaphysique et religieux ne fallait-il pas pour fournir une épine dorsale au présent et au futur, transmettre d’anciennes flammes aux fraîches sensibilités, accrocher de nouveaux rêves aux anciens songes, fournir des sols favorables à des éclosions nouvelles ?
Or, voici soudain que parut le roman ! Et avec quelle vigueur, une inventivité venue semblait-il de nulle part, mais en réalité de toujours, avec tant d’assurance qu’il semblait ne nous avoir jamais quittés. L’imaginaire reprend les commandes.
Ceci nous amène au début du XIIe siècle, sur la fin déjà de ce Moyen Âge qui de fait, dura quasiment un millénaire. Ce fut long et lent, mais tout ceci nous mène malgré que l’on en aie, face à une véritable Renaissance, de toute part les idées, les poèmes et les manières de les lire, de les vivre et de les faire circuler, les mythes et leurs thèmes qui ont pris forme, couleur et vigueur et se sont perfectionnés et affinés, qui ayant mûris presque dans l’ombre, éclatent au grand jour, trouvent un public, qui s’élargit.
Il est difficile de discerner comme on y parvint, au juste. Les érudits en discuteront toujours ? La source d’étonnement et d’admiration la plus évidente à des yeux profanes paraît être la vitesse surprenante avec laquelle se répandirent et se métamorphosèrent les idées, les thèmes, les doctrines, les textes et les renommées en un temps où tout semble d’apparence avoir été et fut réellement si difficile, heurté, dangereux, contradictoire parfois. Et ceci à travers toute une Europe en pleine divisions, guerres de toutes parts, croisades de surcroît voire déchirements politiques. Il est vrai que l’idée de combats, voire de guerres de tous côtés, de prouesses, de rivalités en somme, constitue une part décisive des nouveaux idéaux. Et les élites des deux sexes et cela à soi seul ne mérite-t-il pas de s’en étonner, y adhèrent et y contribuent avec intensité. Or cette « culture » nouvelle si profondément « révolutionnaire » apparaît de si loin comme une, cohérente et globale tant elle se propageait rapidement, sans doute, ce qu’elle n’était pas au départ, c’est plus que probable.
C’était général : les grands chefs-d’œuvre, les doctrines comme les légendes, les thèmes les plus élaborés alors et dont nous nous sommes nourris se retrouvaient et se renouvelaient jusqu’ en Norvège et en Islande, pays Vikings fort dangereux et agressifs par ailleurs ! Ils y prenaient racine en quelques années et y rencontraient un écho si profond qu’ils s’en retrouvaient ou s’en découvraient acteurs et réciproquement (y compris l’apport des sagas islandaises, scandinaves) et ils n’avaient pas été en peine d’en fournir, très créatifs eux-mêmes. Bref les thèmes et les idéaux nouveaux se propageaient spontanément, pour suivre la curiosité, l’avidité générales en dépit des tragédies concrètes de l’existence de peuples multiples et en fréquent conflit les uns avec les autres.
À un point tel qu’il semble, à distance, que ce fut une créativité simultanée et parallèle ou quasiment, et peut-être était-ce le cas ? Qu’en savons-nous ? Nous connaîtrions donc si bien nos ancêtres et sommes-nous en mesure de les suivre de si près pour être leurs juges ?
Que les lumières, l’esprit, l’inspiration médiévale surgirent d’ores et déjà, fussent une importation ou pas vraiment ayant déjà pris racine, les ramifications en vont, voyagent si loin et si vite de par tout le monde alors connu, que cela confère à cette formidable expansion, cette diversité, une unité profonde, mystique, quasi métaphysique.
L’Humain franchit une étape comme un des Chevaliers du temps de ses contes dont il raffole un fleuve aventureux.
Comment trouver, deviner, sentir ce dont il est là question et sans nous perdre traverser la forêt au malicieux instar du Petit Poucet. Figurer comme il y parvint ? Est-il quelque guide ?
Avant tout il ne nous faudra jamais minimiser l’importance de la propagation orale et de l’inspiration qu’elle ne manque pas d’apporter ; nous n’y sommes plus habitués. Au temps jadis elle était la norme, l’écrit l’exception, la référence.
Peut-être pourrions-nous songer à une sorte de tradition homérique de bardes récitant, en quel entourage, en quel contexte ? Au sein même de sociétés restées plus primitives parfois que l’Antiquité classique ne l’avait jamais été tout en laissant place à des improvisations propices à l’innovation et au succès auprès du public. Une forme première de « spectacle ». En remplacement des arènes « païennes » vidées de leurs foules ? Chansons, complaintes et légendes où bien entendu la Chanson de Roland prend sa place parmi d’autres épopées comme les Quatre Fils Aymon, et de plus antiques du reste, encore connues et célébrées ou redécouvertes, mais déjà parts du « répertoire ». D’autres, plus récentes, des complaintes et des légendes, le Roman, courtois ou non, car celui de Renart en vaut bien un autre, de prouesses héroïques, des légendes, fantastiques ou autres, des contes mirobolants ou prosaïques, des récits mystiques ou mythiques, en somme des sillons parallèles, voire simultanés, où telle figure de proue survenant lui venait confirmer sa nature de mythe fondateur prédominant.
Quand un Chrétien de Troyes intervenant en langue d’oïl a pu noyer une préséance et un antécédent d’Oc au profit d’une forme d’affinité élective dont il fixe en quelque sorte le canon dans ses romans, tirés d’Ovide, avant d’accéder au « roman courtois » et de lui conférer son statut de « classique », le doter d’un archétype, il prépare l’avènement du Français. Ainsi, il y bien longtemps fut Homère.
Le processus a pu être le même tant pour le Roman Courtois que pour le Roman de la Rose qui se passionne pour les arcanes, les élans et les procédures de la passion ou même « les » Tristan et Yseut, eux d’origine nettement et délibérément celte, il s’agit là d’amour en son parangon passionnel qui trace la route vers la vision aperçue du vertige de l’absolu en dépit de toute convention « courtoise ».
Le Français a pu au sein de tout cela trouver son chemin se trouver et préparer son unification.
D’une manière ou d’une autre, jusqu’à ce jour où fera irruption je ne sais quel suprême réalisme ubuesque pour prétendre prouver le contraire comme il s’y efforce de temps à autre, le Roman incarne un rêve et une manière d’être à l’égard de la vie qui lui en est et en reste le substrat.
&
& &
Se laisser avant tout charmer par les textes : Arthur règne, la Table ronde est accueillante et il nous suffit de ne pas ignorer qu’au fil de ces exploits héroïques tout n’est pas que fracas des armes et prouesse de héros et de chevaliers aux exploits surhumains.
Certes le contexte est encore simple, le monde binaire : le gagnant ne fait pas de doute, le dragon est voué à sa perte comme le méchant (mais là, certes pas pour toujours ni dans l’irrémédiable.) Œdipe en son temps donnait-il vraiment sa chance au Sphinx et nous est-il indifférent pour autant ? Le conte demeure conte de fées et l’Epopée maîtresse en son domaine.
Si nous sommes sages, nous ne devons pas aller trop loin dans la conjecture et nous contenter de la récolte, écouter et accueillir, se laisser charmer plutôt que critiquer et conjecturer à propos d’un monde où il n’y a pas grand’ place pour le scepticisme ni de mérite à l’incrédulité si le doute amoureux par exemple commence à faire jouer ses arabesques
Sa certaine origine, le souffle martial, épique, fût-il, garda-t-il un temps long et pour de bon une constante profonde ? Bien sûr même s’il se fera répertoire après avoir été mode. La lutte contre les « Sarrazins » figurera tout au long un thème important lors même qu’il sera traité autrement dans le cycle de Renaud de Mayence : les Paladins tellement plus massifs préludèrent-ils aux Chevaliers de la Table ronde comme Rotrou voire Corneille à Racine ?
Ou bien y eut-il auparavant un faux départ ? Après tout si l’Empire carolingien, les structures qui en étaient le fondement et les souverains qui furent ses héritiers ne réussirent pas à perdurer, les conditions extérieures, leurs adversaires aussi les en empêchèrent. Triomphèrent-ils d’eux sans qu’ils aient à ce point mérité leur réputation d’héritiers faibles et incapables ? Ou les deux ? Ne furent-ils pas malheureux aussi ? La chance s’acharne parfois et elle aime presque autant que l’économie fabriquer l’histoire. Le destin de ces monarques peu heureux a pu se jouer au sein de tragédies mal connues, à jamais enfouies, de classiques inexprimés, mais inspirants ? Une grande bataille et il n’en manqua pas ne fut jamais un mauvais épisode à introduire dans un spectacle et Shakespeare lui-même y aura volontiers recours : les trouvères et les jongleurs n’avaient aucune raison d’en faire fi.
Chaque phase de la civilisation y « vit les thèmes qui la hantent et dont ses poètes, ses rêveurs et ses penseurs souhaitent, brûlent de rendre compte comme encore ces créateurs de nos jours que « tenaille l’intense nécessité de s’exprimer ». On peut concevoir qu’alors, en ces époques tourmentées, cet âge sans possible mémoire le sort de maigres manuscrits en quasi-hibernation dans les repaires et les abris qui étaient susceptibles d’en faire usage les, pratiquement alors les monastères, les Cours qui pouvaient en secréter le loisir. Mais qui au juste pouvait détenir le souvenir, le rêve, l’atmosphère, le désir , et tout cela était aléatoire et quasiment épisodique, les centres subsistants ou embryonnaires du savoir, pas tout à fait encore les universités encore en formation, mais auxquelles ils brûlaient de donner le jour, les couvents issus des ordres monastiques nouveaux, les structures commerçantes et leurs villes-refuges franches de fait ou de droit, tout ceci en phase de mise en place encore et en mutation toujours explique quelque léthargie dans la seconde moitié du premier millénaire occidental, avec certes toutes les exceptions que l’on pourra imaginer ou constater.
Mais il n’en demeure pas moins que les pionniers qui furent nos initiateurs ont mis en œuvre et développé alors, dans le flou, l’anarchie et un quasi-isolement, légendes, hantises et rêves ainsi qu’il en a toujours été et que nous le faisons nous-mêmes encore, je l’espère.
De fait, eux, ils l’accomplirent. Et ainsi ils se créèrent « tels qu’en eux-mêmes enfin… ». Nous avons du mal à concevoir ce qu’il pût en être, ce qui se passa au juste ni comment, en ce fin-fond du passé. La sagesse voudrait que nous admirions sans trop poser question ? Perceval qui n’ose s’enquérir nous hante et nous déçoit un peu, mais n’avait-il pas raison et ne suivrions-nous pas son exemple ? Cet état de choses en fait est unique et le restera sans doute : il n’est pas étonnant que les siècles suivants aient été disposés à le nier.
Ainsi peut-être le périple s’initia, les lumières de la rampe s’allumèrent-elles à l’aube du XIIe siècle quand et où les Troubadours du Pays -et de la langue- d’Oc, se prirent à rédiger et à diffuser eux-mêmes ou par le truchement de leurs « Jongleurs » ou tous autres narrateurs et interprètes les poèmes, les mythes, les récits et les légendes qu’ils sentaient vivre en eux, qui s’étaient condensés au fil des siècles, des invasions, des inventions lyriques, recueillis et transmis, médités sans doute et maintenus en vie par des clercs comme par des interprètes divers … et façonnés par le contact avec le public. Ainsi pouvons-nous le penser ? Comment en serait-il autrement et puis cela n’avait-il pas pris forme de longue main, par traditions et transitions essentiellement orales. Toujours est-il généralement admis que le fastueux et fantasque comte de Poitiers, duc d’Aquitaine, Charles IX, à tout seigneur tout honneur, ouvrit le ban et par là même inaugura la littérature française, lui qui fut et demeurera l’un de ses plus grands troubadours ?
Ceci est le fait observable, mais en réalité rien n’est si simple. Ce beau raisonnement peut-il s’appliquer à des communautés, des nations, que sais-je, à toutes les formes en fait que peuvent adopter des sociétés d’hommes confrontés les uns aux autres qui de surcroît rencontrent tant de bouleversements extérieurs qui les contraignent à tout remettre en cause, de fond en comble et sans trêve. Des torrents humains se succèdent de siècle en siècle avec de tout autres desseins: pour assaillir en fait, tenter d’anéantir ou pour le moins s’emparer d’une civilisation, voire d’imposer de surcroît une religion qui vient avec armes et bagages de l’extérieur ou qui bouleverse et dénature de l’intérieur où toute la structure, la raison cède la place à l’épopée et à la légende en pleine action. Voyez le Sud de la Méditerranée où, en parallèle, juste en face, les cavaliers arabes auxquels ont presque immédiatement succédé les cruels apôtres de l’Islam, en une chevauchée de moins d’un siècle avec certes plus d’armes que de bagages avaient réussi à rayer de l’histoire la latinité, la culture et tout ce qu’il subsistait de l’Empire en Afrique du Nord avant de conquérir la plus grande part de l’Espagne où un nouveau demi-millénaire avait été nécessaire avant de commencer à entreprendre leur reflux !
Me revient-il d’expliquer toujours ; constater et admirer n’est-il pas plutôt mon rôle ?
Je serais bien en peine s’il me fallait disserter derechef des « Mille et Une Nuits » et pourtant que d’allers et retours, de traits communs, quels trésors d’imagination se partagent là avec nos lais, nos récits voire nos légendes, à se demander s’ils n’ont pas été puisés à bien des mêmes sources, même si les fées y sont plus peureuses à l’égard d’Allah que les nôtres de Dieu Père et Fils.
Et au même instant chronologique, voire un peu avant, tout au fond de l’Orient le plus extrême la Princesse Murasaki rédige au Japon dans l’ « Histoire de Genji » l’épopée d’une civilisation féodale des plus raffinée, voire plus codifiée encore que la « Find’ Amor ». Les épisodes, les hauts faits d’armes et les rêves ne s’énoncent plus ici en forme de récits et d’épopées, mais comme les pétales successifs d’une peinture de fleur. Comment approfondir, sinon à travers le songe ?
Il y a trop d’émerveillement et de bonheur intellectuel… et littéraire pour ne pas faire nôtre sans autre forme de procès toute cette effervescence en un si bref espace de temps que bien des savants objectifs et minutieux considèrent comme une Renaissance dans sa globalité et cet embrasement généralisé tout en se gardant d’aller trop loin dans l’analyse et la précision généalogique de ses idées et de ses thèmes comme les médiévistes savants sont dans l’obligation de le tenter. Est-il tant besoin ici de critique ni même de raisonnement : là réside le privilège de l’amateur.
Il n’est certes pas question d’ignorer leurs découvertes ni même d’aborder leurs conclusions, mais de se livrer sans réticence au charme et à la griserie de tant de thèmes et de perspectives nouvelles plus séduisantes les unes que les autres, les fruits exquis de ces vergers bien défendus dont le concept était à la mode surgis de partout où nos ancêtres voyaient si volontiers accéder leurs héros et comment pourrions-nous récuser le souvenir du Jardin des Hespérides dans notre soif d’y pénétrer !
Bien des choses advinrent en cette si brève effusion qui prirent leur vol et qui durèrent si longtemps…
&
& &
Un siècle à peine avant que la rigoureuse histoire, qui fut dans l’ensemble de la période dite médiévale agitée comme jamais de peuplements complexes venus de toutes les directions buter sur la mer, voire en surgir comme les étranges Vikings aussi avides et cruels qu’ils étaient poètes, barbares, car importants marchands d’esclaves ils étaient peu enclins à un christianisme désastreux pour les affaires, créateurs et intelligents aussitôt qu’ils eurent l’occasion de le montrer.
Saxons, Slaves, Finnois, Huns et j’en passe avaient suivi et succédé aux Celtes et aux Francs et in fine tous s’accumulaient au travers des combats et des guerres qui ne les épargnaient pas eux-mêmes.
Avec à l’origine l’optimisme de son orgueil et de sa fierté, l’Empire romain avait toujours tenté d’assimiler l’apport extérieur, de le dissoudre. Les envahisseurs les plus avisés de leur côté avaient initialement eux-mêmes largement utilisé son cadre, son implantation voire s’abritaient derrière ses armées aux frontières du « limes ».
Puis les Arabes se précipitèrent sur la péninsule Ibérique en tenaille, accentuant encore la pression, désolant la région méditerranéenne et occultant temporairement l’éclat de cette zone, mère de toutes nos civilisations, ce qui aboutira finalement à terminer le Moyen Âge, mais nul ne le savait encore.
Cette bénédiction à laquelle nous devons notre civilisation, cette malédiction d’alors furent l’indéniable résultat de cette étrange configuration géographique de l’Europe occidentale, sorte de gigantesque promontoire où se confrontaient tant de multiples exodes ou envahissements de ces peuplades, elles-mêmes bien souvent poussées par les épaules, qui se retrouvaient dans l’impossibilité de poursuivre leur pérégrination, moins encore de rebrousser chemin.
Ce faisceau tout à fait exceptionnel conforte si bien dans sa vision le « spectateur émerveillé » qu’il lui semble un privilège de se retrouver dans cet environnement « magique » caractéristique de l’époque dans son ensemble, soumise elle aussi à la dure tyrannie de l’histoire, confrontée à la spontanéité de l’imprévu, la cascade des causes trop souvent suivies de leurs dramatiques effets.
Mais il demeure incontestable que lorsque les troubadours d’Oc se prirent à chanter l’Amour et le rêve ou le rêve de l’Amour à travers le dur monde féodal, ils émirent un chant nouveau et des thèmes qui s’avérèrent rapidement d’une profonde originalité et d’une nouveauté absolue dont l’inspiration et l’empreinte plus latines revisitées avaient d’ores et déjà puisé certaines formes de leur renaissance.
Alors les trésors jusqu’alors enfouis et dispersés dans le tumulte et les tourments de l’histoire furent en mesure de revoir le jour.
Il est plaisant et passionnant de considérer comme tout ceci s’anime, s’avance, masqué parfois.
De considérer des mythes, des thèses qui tout à coup s’animent, s’incarnent, se déchaînent, dominant l’époque et lui confèrent sa physionomie, cette unicité, cette créativité surtout dont la puissance reste énigmatique et qui brilleront avec vigueur pour mieux s’effacer, se mettre en veilleuse tout le moins au long de la « Renaissance » classique qui vit revenir en force les grandes structures, les visions intangibles propres à l’Antiquité toujours triomphante qui aux yeux de nos ancêtres (plus) immédiats étaient aux siècles classiques celles de la civilisation proprement dite et ils le crurent en toute bonne foi sans avoir tort le moins du monde. Mais le ver était dans le fruit.
Il y eut là certes tout au long beaucoup de politiques, les Royaumes et les Empires, les Puissances urbaines (peut-être est-il aventureux de considérer comme proprement Républiques les entités oligarchiques de Venise ou Gênes, la Papauté, certes ou la Hanse) qui ressentirent la profonde nécessité d’être enchâssées dans des lois, des statuts, des religions, des dynasties, bref des configurations que le Moyen Âge de la féodalité eût été bien en peine par lui-même de mettre en œuvre non sans l’avoir tenté (Charlemagne, Frédéric I et II, les Hohenstaufen voire le Pape) sans parler de Byzance encore debout tentant de survivre, mais dont la chute définitive fermera le rideau tandis que se faufilaient vers la modernité les Rois de France et d’Angleterre laissant se débattre l’Empire Romain-Germanique ou ce qui tentait d’en survivre.
Rien n’est simple : qui est un troubadour, au juste et quel est-il ? Car il en fut de toute sorte ou ne comprenons-nous plus certaines dimensions ou modes de vie, qui nous échapperont à jamais ? En tout état de cause il semble devoir être un créateur : certains des plus hauts seigneurs de la féodalité en revêtent volontiers le costume (Charles d’Orléans encore… au XVe siècle !), Charles IX d’Aquitaine, Comte de Poitiers, qui même fut le premier à revendiquer ce titre chez lui inattendu et en serait-il ainsi le doyen de la littérature française ? Mais il désigne aussi le simple metteur en œuvre (on n’ose dire metteur en scène) d’une sorte de spectacle qui se déplace de place en place, sinon de théâtre, du moins d’estrade.
Son semblable, son répondant est le trouvère de la Langue d’Oïl ou subsiste-t-il des nuances ou des différences ?
Le Jongleur (ou bien le ménestrel) est-il voué lui-même au simple rôle d’un exécutant ? Il récite le poème, la complainte ou le récit de prose, mais il l’accompagne de l’instrument de musique qui soutient sa voix -et l’intérêt de son auditoire ! – peut-être même dansant et exécutant quelque tour puisque toute cette littérature est essentiellement orale, verbale voire dialoguée et mise en scène et dès lors de quels sketches s’encadre-t-elle ? Un peu de tout cela peut-être ; nos ancêtres n’étaient pas moins imaginatifs que nous et devaient « faire le spectacle », le varier et les publics aussi !
Certains jongleurs revendiquaient leurs œuvres. Est-ce avéré ? Non seulement la nuance était floue, mais nul ne semblait s’en beaucoup soucier ; ce que nous en savons de plus précis provient en général de l’auteur lui-même qui, assez souvent tel Chrétien de Troyes dédie son œuvre à son commanditaire avec quelques propos sur la commande, son dessein ou ses raisons d’être, voire d’aller jusqu’à feindre « ? » de s’en voir dicter le texte ou imposer le déroulement (on n’ose dire le scénario). Il y avait bien là parfois une arrière-pensée de prudence en s’appuyant de surcroît sur plus fort que soi ? Et d’en bénéficier aussi !
Cette configuration entre « oral et écrit », cet aller et retour édifié par une société, sa civilisation enfin féodales si l’on peut dire a été, est devenue on ne peut plus rapidement et complètement un art de Cour raffiné, car tout allait vite et à fond quand il était question d’évoluer dans ces cellules restreintes et ardentes de jeunes et enthousiastes communautés. C’est là qu’il s’exprimait le plus largement, le plus efficacement… et le plus librement possible, car il ne fallait pas négliger le lourd regard clérical et sa menace de censure voire bien pire et que les « artistes » prissent grand soin de respecter leur territoire et de leur y donner des rôles flatteurs, mais la compréhension, l’appréciation, l’enthousiasme et le jugement et la diffusion, le résultat en somme étaient d’une rapidité confondante. Cela valait pour tous les intéressés : l’avidité et l’enthousiasme de même.
De plus en plus nombreux au fil de ces années qui se déroule si vite l’auteur du manuscrit ou celui qui le dicte en déclarant vouloir modestement (?) rapporter quelque légende ou récit ce qui peut être vrai après tout et peut-être aussi parfois souci d’éviter ainsi blâme ou censure ou bien pire encore) prend soin, dans son préambule au moins de revendiquer, de donner son nom ou sa qualité ; ou alors intervient-il, prend-il le lecteur ou l’auditeur à témoin pour dire quelle merveille est en passe de se produire, de se révéler. La publicité n’est pas née d’hier.
Bref tout est possible : ils sont inventifs, aussi bien pour produire une légende, une aventure « réelle » vécue par des personnages qui ne le sont pas moins dans un monde ostensiblement fantasmagorique que pour promener leurs personnages dans de vraies villes métamorphosées ou de créer des contrées imaginées dans des pays aussi bien l’un que l’autre inclus dans la même fantaisie évocative. Dès lors que l’on s’embarque ou que l’on chevauche, l’imaginaire et la féerie interviennent. Tout ceci de peu d’importance, voire de convention. Roman vous dis-je. C’en est au point de s’interroger, si certains de ces obstacles, de ces farouches intervenants, de ces déplacements ou de ces magiques épreuves ne répondent pas à certaines conventions plus ou moins codées qui nous échapperaient quelque peu aujourd’hui ?
C’est ainsi que ces troubadours d’Oc furent les évidents précurseurs, les défenseurs, disons plutôt les champions de l’Amour et des Dames qui en avaient l’accès (non pas toutes) comme de la manière dont elles le percevaient, l’entendaient ou voulaient se l’entendre proposer, ce qui était sans doute plus inédit, de la courtoisie aussi, les révélateurs comme les chantres de sa fondamentale complexité, des circuits de la séduction et de son enchantement, de sa puissance… Là était le cœur du terroir de la civilisation antique et là s’était-elle le plus profondément amalgamée au paysage, en liaison restée vivace avec son passé et cette Rome qui se refera dans si longtemps Italie puis Renaissance.
Certes ne l’ont-ils pas inventée, mais ils l’ont retrouvée et renouvelée à notre usage.
Un « détail » saute aux yeux : le caractère tranquillement adultérin de l’amour « courtois » ou du moins son indifférence absolue en tout ce qui concerne le mariage officiel dont on peut se demander qui l’y a introduit dans le processus : le mariage est un contrat d’affaires à la base du système de transfert de la propriété terrienne, au cœur du système féodal.
Les dames de la haute société de l’Ancien Régime semblent s’en être toujours souvenues…
Cette montée en puissance de leur culture dans ces sociétés anciennes donna le jour à quelque profond sentiment, un mouvement d’unicité du Sud vers le Nord comme aussi du nord vers le Sud sans doute, de ferveur et de cohérence des deux « mouvements » du siècle, l’amour-destinée et « fatal » que nous nous hasardions à nommer Celte et l’amour-courtois, policé, trouvant davantage son origine en Oc peut-être, plus Latine et sociable. À cette approche serait plus volontiers confié le cérémonial de la poursuite amoureuse, de la conquête des cœurs et de l’esprit, de la démarche civilisée et raffinée qui se trouvera restituée dans l’évolution des mœurs voire distillée à l’Hôtel de Rambouillet et dans les salons et les boudoirs successifs de la société.
Si la terre d’Oc est indubitablement le Sud nous ne devrions pas le voir comme celui seul de la Méditerranée. Le plus créatif de l’apport littéraire qu’elle fournit semble en être le centre de la France actuelle, sous la coupe de cet illustre comte de Poitiers ainsi que les Dames d’Aquitaine de sa postérité qui généra la saga des Plantagenêt et faillit bien réaliser dès lors une synthèse France-Angleterre plus féodale qu’étatique. C’est alors que la Comtesse de Champagne, fille d’Aliénor commandait « Lancelot du Lac » à Chrétien de Troyes qui écrivait en langue d’Oïl et lui en dictait le scénario (qui n’était pas vraiment selon son cœur résolument dévot dit-il… ou bien se souciait-il quelque peu de sa sécurité ?) en même temps qu’elle méditait avec sa mère les modalités de l’articulation des couronnes de tout l’Occident et leur devenir !
Nul n’avait jamais dénié l’empire d’Éros, les Grecs et les Romains moins que tout autres. Mais son carquois, s’il était sans faille, n’avait pas encore toutes ses flèches (en viendra-t-il au bout un jour ?) et jadis après qu’il eût atteint sa proie l’on ne discutait plus guère le pourquoi ou le comment qui se faisaient intangibles même s’ils devaient être provisoires. Il n’a pas été inventé maintenant, puisqu’il est de tout temps, Éros ou l’Amour, s’il n’était peut-être pas au fond si différent, n’existait et surtout ne parlait pas de même et serait-on tenté de dire : pas autant… Mais bavard, de plus en plus !
Certes l’Iliade nous apprend comment Aphrodite déclenche la Guerre de Troie, qui, pour récompenser Pâris, le second fils du Roi Priam de son jugement trop judicieux lui procura l’amour de la belle Hélène, la plus belle au monde, épouse de Ménélas qu’il enleva en conséquence et il ne sera plus question d’elle, mais d’Andromaque à qui son frère Hector fit ces émouvants adieux qui firent de lui le héros le plus s’sympathique de l’Iliade avec son père. Le solennel combat singulier au cours du siège de Troie entre Achille et lui n’est pas sans évoquer, annoncer l’étiquette moyenâgeuse.
L’Amour sait être intense et profond et les hommes ne l’ignorèrent jamais, Sapho non plus, même s’ils savent le mettre de côté quand cela leur convient. S’il n’a pas été inventé au XIIe siècle, du moins y a-t-il trouvé les canons, les morphologies, les mystères et puis aussi les modalités suivant lesquelles il nous régit encore de loin.
Vainement les siècles « classiques » si l’on admet comme tels les XVIe, XVIIe et XVIIIe encore ont-ils pensé le découvrir, le retrouver plutôt sur l’ère de l’antiquité approfondie par leurs soins, sous l’empire de la spiritualité, de la raison et de l’analyse tout en déplorant en termes voilés, presque à regret la puissance de son emprise dans le cours normal ou à peu près de ce qu’il en était jadis. Comme si l’on tentait de réduire la magie « Celte ». Il a opéré un retour en force depuis le Romantisme, aidé par la science autant que par la conscience et surtout par la souvenance et le retour en force de l’affectivité de ces temps du lointain passé qu’il avait invoqués.
Nous voici donc en présence de ce douzième siècle où le rideau se leva. À nous d’en savourer les trésors.
Dès l ‘Antiquité civilisée, grâce notamment à la poésie, l’Amour avec un grand A était parti à la campagne grâce aux églogues comme s’il était devenu ridicule en ville: la partie pastorale de l’existence rurale fut toujours en effet le constant théâtre de la vie amoureuse locale, fruit sans doute de la nostalgie des poètes urbains pour les charmes du folklore et resta un thème important dans la diaspora de l’époque Alexandrine et de la civilisation hellénistique méditerranéenne. Notre Moyen-Âge, qui en vivait les exactes conditions, l’exprimait avec moins d’emphase.
Plus décentralisées sans doute depuis que l’Empire se disloque, littérature et poésie chantent volontiers la vie agreste, voire provinciale, sa sagesse, s’amusent à imaginer l’Amour aux champs, son éveil dans la conscience à travers le spectacle et les rythmes de la Nature munificente, plaisirs toujours réservés ceux-là aux bergers et bergères heureux et paisibles. La part des vulgaires laboureurs est plus ténue : il leur revient le simple droit à une longue vie de bonheur conjugal. Le Daphnis et Chloé de Longus, élaboré dans le laboratoire prédestiné de Lesbos au IIIe siècle aura l’honneur d’en fournir, le prototype pour l’histoire. S’ils s’avisent d’être tragiques, les amants d’alors, plus mièvres qu’antan, se noyaient en traversant le Bosphore par exemple ainsi Léandre pour retrouver Héro, dans la « petite épopée » d’un Musée qui n’existe pas par ailleurs. Cette pastorale simplicité sonne un peu faux et elle est bel et bien décadence, présageant Jean-Jacques. Du moins Léandre y gagna-t-il de figurer le prototype de l’amoureux de toute la comédie italienne comme du théâtre classique.
L’amour se voudra dorénavant « courtois » ? Est-ce une indication de provenance, quand il osera se dégager des classiques, d’un Moyen Âge qui nous achemine déjà vers la cour d’Arthur, décrit une passion, modèle une conception du monde, engage l’être de manière quasi métaphysique ? La figure de proue en est ainsi figurée par le mythe de Tristan et Yseut
Bele dame si est de nous
Ne vous sanz moi ni moi sanz vous
L’Amour en chacune de ses facettes figurera un mode de vie : celui de Tristan n’est pas antagoniste de cet amour courtois, mais il n’en relève en rien. Est-il ou n’est-il pas antérieur ? De quelle provenance géographique l’un comme l’autre ? Cette question est si prégnante que nulle réponse scientifique ou psychanalytique ne pourra à elle seule la satisfaire et nos savants contemporains paraissent s’y aventurer surtout par affinités.
Pourtant plus hardie que nuancée, l’époque elle-même n’eut pas l’audace de l’assumer en tant que passion humaine. Il part de trop loin, il plonge trop profond : il lui fallut l’imputer au sortilège du « boire » magique.
La littérature comme la tradition les confond facilement. Il n’empêche, l’un n’est pas soluble dans l’autre et le Tristan mythique emporte tout sur son passage. Même s’il s’assied à La Table ronde où il a place entière et sait tenir son rôle si les circonstances l’y amènent, il ira « aussi » errer en ville comme un maraud ou vivra en sauvage dans la forêt avec le même opportunisme obsédé et aucune expression de désarroi s’il l’impose à l’objet de sa passion. Du remords seulement Au contraire son ingéniosité sera sans faille et sans mélange si les circonstances l’y amènent. Ainsi en agira Yseut de son côté si le « vous sans moi » entre vraiment en jeu (elle se pliera par ailleurs sans faire de manières dans un adultère « classique » quand besoin en est) : dans les deux cas, les péripéties des amants témoignent dans diverses circonstances d’un caractère étonnant, profondément symbolique, mais volontiers drolatique et bizarre où devait se déployer la créativité des interprètes ? (Tristan faux lépreux chevauché par Yseut après son serment tarabiscoté, les rendez-vous dans les jardins du Roi Marc qui les surprend caché dans son arbre et qu’ils dupent parce qu’ils s’en sont aperçus, voire, plus graveleuse que crédible, sa nuit de noces interprétée par la fidèle Brangien qui y consacre son pucelage). Ainsi un personnage tel que Marc, et Tristan lui-même revêtent-ils une double face, parfois sublimes l’un comme l’autre, parfois grotesques, voire odieux : un étrange mélange de Roméo avec Figaro pourraient-ils figurer, enjambant les siècles, le double et spectaculaire attelage du troubadour et du jongleur ? La tonalité est bien plus shakespearienne que classique si par ailleurs le mélange est étroit : quand les hasards de l’épopée et les virages du récit entraînent les preux chevaliers voire les rois à jouer les rustres, ils y vont sans ambages.
Ainsi se met en place, sans se scinder, la scénographie complexe qui façonnera progressivement celle de la Comédie humaine et paraît le côté visuel, spectaculaire de cette littérature « dramaturgique » médiévale que lui confèrent ces tableaux successifs et contrastés au charme naïf si l’on veut, mais tellement parlant que l’on s’abandonne au plaisir de s’en laisser conter.
Dans l’ensemble de ces épopées, de ces contes et fables, lais et romans s’entrelaceront deux amours qui ne manqueront plus de cohabiter, de se mêler alchimiquement l’un avec l’autre dans toutes les incarnations imaginables et le roman désormais ne sera plus en peine de nous en fournir : l’amour violent, instinctif, irraisonné et celui qui s’obtient, se fraye un chemin avec ou sans calcul, innocent ou machiavélique. Plus tard, l’innocence prendra un beau ( ?) jour le nom d’instinct.
Saluons l’invention de l’amour-destinée aux profondes résonances, cet amour-catastrophe de Tristan et Yseut, si inédit et choquant, à proprement parler scandaleux, qui remplaçait dramatiquement le malicieux Cupidon avec son arc. Personne n’en a osé dire qu’il fût naturel puisqu’il avait fallu ce philtre administré par une Brangien distraite pour le projeter sur l’homme qui de fait n’en a jamais appris beaucoup plus depuis ces jours lointains, indéfiniment confronté depuis avec cet amour qui se mérite, s’obtient, se recherche, se conquiert, tout ce que l’on voudra et où les femmes, nous le verrons, s’efforcent inlassablement, ouvertement à définir, multiplier, cataloguer les approches tout en suivant la mode d’ailleurs.
Tout pourra se recomposer dès lors et Tristan se retrouver en temps et en heure autour de la Table ronde à laquelle il appartient de droit même si cela demeure le cadet de ses soucis.
Ses origines concrètes : un manuscrit en Allemagne, le plus ancien qui nous soit parvenu, mais qui n’est visiblement pas le premier ni ne se réclame comme tel puis Béroul et Thomas qui donnent des récits complémentaires, différents parfois et beaucoup d’autres fragments çà et là, un peu partout et simultanément ce qui en démontre la vogue, mais jamais vraiment d’auteur invoqué ou revendiqué : Chrétien de Troyes en aurait rédigé un qui a été perdu ou n’a pas été concrètement écrit, d’autres épisodes ont été rapportés, d’un peu partout. Cela suggère une vie orale et légendaire profonde et intense, les imaginations se déchaînèrent et elles le font encore : le mythe avait touché un nerf.
La question qui se pose est de savoir si nous en sommes fiers ou inquiets : les deux et c’est compréhensible. Quelques esprits conciliateurs dès ce lointain Moyen-Âge ont souhaité transiger : le boire amoureux ne durerait que quelque temps (on suggérait cinq ans) : je laisse à penser ce que l’on en peut juger ?
La grande consolation que nous laisse pareilles lacunes reste que ce sort et son histoire ont voulu, exigé que Tristan demeurât à jamais insaisissable : la seule certitude que nous en avons est qu’il s’agit là d’une très vieille légende d’origine celte. Cela suppose une vie orale et légendaire, une passion avide soutenue et intense : les imaginations se déchaînèrent et elles le font encore même si nos temps cyniques doutent de sa vraisemblance.
Il convenait désormais de dompter, d’apprivoiser cet Amour qui venait d’administrer de telles preuves de sa violence et de sa puissance, d’en posséder les recettes, des marches à suivre, à donner des récits aux rêves ; il reste pour nous à deviner comment ils s’y employèrent, à s’ébahir et à s’étonner de tant d’imagination et d’aisance pour passer du vraisemblable à l’imaginaire, du croyable à ce qui ne l’est pas, ne peut l’être, se rappelant toutefois que l’époque était d’esprit singulièrement moins critique que la nôtre. Pour bien rêver et s’émerveiller, l’on était prêt à toutes les fantaisies de l’imagination ; aucun « réalisme » n’était requis. Mais quand c’est le cas, qu’il est convoqué, il se fait au sein d’une sorte de violente satire qui ne recule jamais devant le grotesque ou le truculent.
À retrouver ou tenter de reconstituer ces puzzles, on ne peut s’empêcher de penser qu’une certaine codification, des conventions virtuelles, l’époque enfin voulaient que les esprits, ceux du public comme du lecteur, se retrouvent à ne pas ignorer complètement où l’on en était : de par le mécanisme de tel ou tel enchantement, l’accomplissement d’un type de prouesse-formalité, des voyages codés au travers desquels l’audience ou le lecteur admettait qu’il se trouvait en quelque autre « univers » selon le mode d’après lequel se réalisait la prouesse, à charge pour lui d’en tirer les conséquences.
Bref quand les Troubadours d’Oc se prirent à chanter l’amour, à en poursuivre l’imaginaire de par le dur monde féodal, ils émirent un chant nouveau, sur des thèmes d’une profonde originalité, mais sur un fonds plus civilisé peut-être, aux passions plus maîtrisées, moins loin de l’imagination, la sensibilité et l’expression plus latines de jadis dont leur terroir n’avait pas perdu le souvenir.
Si la terre d’Oc d’alors est indubitablement le Sud, nous ne devons pas le voir comme celui seul de la Méditerranée : elle ne se superposait pas avec celle d’aujourd’hui ; son cœur battait alors dans le sud-ouest actuel et le centre de la France, plus prospère alors et plus homogène avec une élite de grands féodaux où la société était définie. La vie de Cour y fleurissait surtout autour des grandes dynasties régnantes, essentiellement au centre du sud de la France, les comtes de Poitiers, les ducs d’Aquitaine et les comtes de Toulouse encore, qui se fédéraient à leur guise jusqu’à la guerre albigeoise quand les reîtres du Nord s’en vinrent troubler la fête : les rois de France quant à eux se souciaient de leurs affaires.
Là s’organisèrent le code de la chevalerie, ses jeux, ses compétitions, ses joutes, tournois et parades (parmi leurs distractions favorites : le figurer, le mettre en jeu en constituant des concours, des sortes de jurys (féminins bien souvent) pour en délibérer, en gloser et en dégager des conclusions. De la chevalerie et du bien dire, celui de l’amour et celui de la prouesse, face aux dilemmes issus de tout ce contexte aussi bien que des faits marquants de l’actualité, des prouesses plus ou moins transfigurées suivant les circonstances :l’Hôtel de Rambouillet et la mode précieuse en leurs premiers débats.
Là et ailleurs la tradition orale, l’oral avant l’écrit, l’oral qui s’est écrit et en fut la source et le facteur primordial sinon le plus savant de sa transmission , joua semble-t-il un grand rôle pour diffuser, mais aussi pour faire évoluer, accentuer, bouleverser en mille façons tous les aspects de ces récits, leur mise en scène, leur passion des énumérations comme leur exagération sans vergogne, mais si tentante de toutes les cérémonies, les divertissements, les évènements, les cours des royaumes supposés ou rêvés, interminablement décrits, transfigurés par l’imaginaire. A beau mentir qui vient de loin.
Mais l’appétit, la faim de beauté et de rêve, le besoin d’instaurer un cadre, un modèle, des guides pour « situer » les sujets et les héros étaient tels que, de par et aussi complètement en dehors de ces bases que l’on n’oserait nommer institutionnelles, car elles se paraient rapidement de tous les instruments de l’imaginaire, rencontraient de temps à autre l’œuvre d’un auteur d’imagination qu’elle avalait sans vergogne, s’incorporait et qui se retrouvait garant, responsable ou à peu près de tout un univers. Écrit et oral : les deux.
Ainsi en advint-il du Roi Arthur, de l’enchanteur Merlin, qui eurent bon dos pour cautionner, de tout ce qui ressortait de leurs rôles respectifs et de la miraculeuse merveille, la géniale invention de la Table ronde, vouée à entrer dans l’histoire universelle de l’humanité et dans les constellations d’astres, apparemment venue de nulle part.
Une curieuse péripétie, un étrange phénomène intervinrent alors, que l’on peut, qu’il faut à peu près intégralement retrouver le tout dans les deux ouvrages, romans déguisés en livres d’histoire, de Geoffroy de Monmouth.
La matière était en telle fusion que lorsque l’on désigne un lieu, la trace historique d’un évènement dans la littérature médiévale, c’est pour en faire un imaginaire, cesser toute représentation un peu réaliste, y déverser ce magma en fusion. Ce fut tout uniment grâce aux livres de Monmouth servant en quelque sorte de caution que la légende arthurienne a pu s’emparer, s’est cristallisée sur la personne d’un Arthur de la fin du VIe siècle, roi ou important chef de guerre en Grande-Bretagne et lui a insufflé sa vie, ainsi qu’à tout son entourage.
La Table ronde est à la base un concept essentiellement religieux intégrant diverses aventures héroïques à vocation pieuse dans un cadre chevaleresque et légendaire, parallèle aux épopées courtoises et situées dans le même cadre de civilisation médiévale sauf peut-être l’importance plus grande des ermites qui font ici figure de guides, d’orienteurs et surtout de devins face aux énigmes et aux évènements sur les mêmes codes de la chevalerie courtoise. Il s’agit de retrouver et de révérer in vivo le Saint Graal, le vase mythique contenant le sang du Christ crucifié. Cette vision, cette tradition étaient construites et maintenues dans les Monastères de l’ordre de Cluny et ont trouvé leur incarnation la plus achevée dans le Roman Gallois de Perceval, la dernière œuvre (inachevée) de Chrétien de Troyes.
Elle visait, autour d’Arthur, parangon de la Royauté chevaleresque médiévale, de son éthique et son orthodoxie, à montrer « au mérite » une parité entre les uns et les autres et à élire leurs diverses démarches, pèlerinages mystiques environnés, plongés bien sûr dans différentes aventures héroïques et initiatrices. Le moins que l’on puisse en dire est qu’elle remplît son office avec succès et qu’elle étendit sa suzeraineté à l’ensemble de la littérature et de l’expression médiévales : elle plane encore.
Proprement arthuriens, ils reproduisaient ainsi dans un halo d’épreuves mystiques et dans un univers peuplé des mêmes péripéties les aventures palpitantes des preux plongés dans les volutes de l’amour « courtois ».
Le cycle de la Table ronde avait été ainsi nourri, transcendé, revisité, inventé parfois, doté aussi d’un fond « historique » l’authentifiant en quelque façon par ce Geoffroy de Monmouth, auteur anglo-normand qui écrivit, inventa froidement plutôt à l’orée du XIIe siècle de la Cour de Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine l’ « Histoire du Roi Arthur » en 1211 et « l’Histoire de Merlin » en 2018, donnant une impulsion décisive et internationale au « corpus » dans son ensemble. Dans l’équivoque la plus absolue.
En ce qui concerne la civilisation médiévale comme il en serait pour les autres, mais plus intensément peut-être puisqu’elle est en tant que telle la plus mise en doute et controversée, la question que nous pose sa littérature et grâce à laquelle elle s’anime et se met à vivre au sein de l’époque qu’elle traverse, est peu ou prou de savoir pourquoi et comment elle s’ assume et se considère elle-même, de son génie propre et son authenticité, en bref tout ce dont elle userait éventuellement plus tard à sa propre encontre pour se dénigrer soi-même et s’autodétruire comme il en est si souvent advenu au cours de l’Histoire pour en devenir une sorte de destin.
Dans ce cadre sans doute jamais la littérature, l’imagination et la civilisation qui l’animent, ne se sont situées à une telle distance non seulement des sociétés dans laquelle elle baigne, mais des réalités historiques et des contingences objectives qui les auront abritées les unes et les autres.
En l’Empire de Chine, peut-être ?
Certes la société du temps comme bien de ses plus puissants contributeurs étaient singulièrement contrastés entre eux, fut au point même de l’incohérence et très dépourvue par ailleurs de regroupements stables. Bien des puissants certes porteurs de savoir-faire, de ruse, d’expérience et d’intelligence ne trouvaient de temps pour rien d’autre que pour maintenir et consolider leur pouvoir : ceci est de tout temps, mais alors particulièrement. Voyez les Rois de France !
Elle a certainement représenté, si on veut bien l’admettre comme une civilisation, ce qui n’a pas toujours été le cas : les Anglais parlent plus volontiers de « Dark Ages » que de « Middle Ages », elle aura sans doute concerné, été accomplie par l’élite la moins nombreuse par rapport au reste de sa population. Ce fut aussi la raison pour laquelle elle fut si transparente à elle-même, si réactive et si rapide dans son évolution et son expression. Sa disparition aussi, comme sur la pointe des pieds.
Dès le XVe siècle, on se préoccupera de tout autre chose. Découvrir l’Amérique par exemple : si Marco Polo vécut au XIIIe siècle et qui fut bien seul à effectuer son périple à l’instar sans doute de nombreux marchands bien incultes qui eux n’en rapportaient qu’un émerveillement ébahi. Mais il était, lui, Marco Polo.
Le Moyen-Âge n’évolua pas nettement non plus dans le sens du progrès, on peut être frappé de la stagnation scientifique qui fut la sienne, à l’exception de quelques techniques (souvent militaires : la poudre à canon, la stratégie) qui résultaient surtout du voisinage et de la mixité de peuplades si diverses. Mais il n’en fut certes pas de même quant à ses doctrines religieuses. Elles surgissaient de toutes parts, en son sein comme hors d’elle.
Mais civilisation elle fut vraiment : il suffit de regarder l’évolution et l’accomplissement de son admirable architecture du roman vers le gothique, de l’art monumental « Rhénan » à la profonde élaboration idéaliste et d’inspiration quasi métaphysique et l’influence byzantine aux imbrications orientales. Ceci sans doute en parallèle avec les évolutions monacales, religieuses et théologiques. Ses successeurs « néo-classiques » ont étrangement considéré toute cette époque comme une dégénérescence. Il faut encore mentionner son évolution dans l’ordre militaire, Châteaux-Forts et fortifications en tous genres, enfermement des villes pour répondre à celle des guerres. Ne regardaient-ils pas, n’avaient-ils pas une pensée pour les monuments qu’ils avaient partout sous leurs yeux ?
Dans les mœurs ? Il faut nommer surtout l’assise prise par la religion -les religions- devrait-on pouvoir dire tant s’y heurtèrent de doctrines mystiques, d’hérésies et de schismes comme surtout la dyarchie progressive puis décisive des Empires d’Orient et d’Occident, souvent source de graves conflits tels la croisade albigeoise contre les cathares, l’irruption de l’Islam par-dessus le marché.
Certes, son élite s’élargit à mesure, du fait de l’extension des centres de l’étude : villes, monastères, universités, etc.
Toujours est-il que c’est à la littérature et la poésie, la légende et la féerie, pour les genres sérieux à la théologie et à la morphologie de l’entendement, tout uniment à la « conception du monde » pour se conformer à la casuistique moderne qu’il nous faut avoir recours pour déterminer ce décisif apport médiéval à l’être humain, qui en tout état de cause aura permis ce coup de reins transcendant d’où naquit pour le meilleur et pour le pire la civilisation moderne face aux autres « gisements » du monde connu des grandes civilisations géographiques, globalement plus statiques.
Cet ensemble fut généré, il nous est possible de le discerner à présent à partir des centres du pouvoir que constituaient les diverses « Cours » où il s’exerçait, dans les monastères, dans les universités débutantes comme aussi des cités avant tout marchandes.
C’est ainsi qu’il nous faut ouvrir nos livres et nous en repaître selon les exigences et les appels de notre cœur.
Songer à la rituelle amoureuse, aux lyrismes qui la traduisent, à la poésie et à l’imagination, voir et pouvoir ressentir la violence de la passion de Tristan, le fracas des combats, les exigences surhumaines de l’amour courtois, celles de la société tout entière auxquelles ne nous faut-il pas joindre celles de la théologie et de la foi, de la, des religions dans leur ensemble avec leurs fanatismes divers, leur cruauté aussi, la dure approche de la sainteté sous les formes apparemment antagonistes de l’ermite et de l’ordre monastique, quelque part réconciliées dans la synthèse offerte par l’ordre bénédictin. À l’écho parfois différent peut-être qu’il peut évoquer en chacun de nous, pas forcément ressenti comme tel.
Sa passion aussi : on ne voit pas de guerre ou d’invasion antique basée sur quelque prétexte religieux que ce soit ni à vrai dire jusqu’ici le souci de conquérir à seule fin de civiliser autrui voire même de lui imposer sa croyance ?
Il reste à vrai dire que ce sont les fidèles d’Allah qui imaginèrent de placer leur conquête sous ses auspices avant que les croisades ne leur répondent en tentant, sous la rubrique du pèlerinage et de l’accès aux lieux saints, de les rendre à leurs adorateurs ?
Il est vrai de plus qu’une esquisse de pacification parut se profiler au début des croisades ? Mais n’en est-il pas moins exact que la hantise du butin et du pillage restait toujours latente, que ce soit dès le rassemblement, le départ ou en cours de route.
Mais d’un autre côté aucun marxiste ne pourra nous convaincre de la vocation économique des croisés ou des cavaliers arabes fonçant vers Gibraltar plutôt que de rêves d’épopées et de pillage purs et simples.
Par contre Tristan, pour les beaux yeux d’Yseut, ne saurait-il pas se croiser comme lui et ses homologues l’ont fait maintes fois sous d’autres auspices ?
Si la puissance de l’esprit et de la foi amenèrent de tels bouleversements dans la mentalité et la culture, le domaine donc de l’imagination et de la passion, celui de l’amour et de son culte durent en être bouleversés et ils le furent. Le désir de l’homme, la poésie qu’il porte en lui et sa passion, comme l’aspiration à ce qui peut être le bonheur ou le représenter nourriront à jamais la littérature et la prose, l’introspection et la créativité qui constituent son apanage.
&
& &
Des Dames
Plus que les autres paradigmes, à en juger par la rapidité et la brusquerie de son évolution, en ces quelques décennies, tout, au Moyen Âge, s’est concentré, sublimé, cristallisé et comme directement transfiguré en dogme et en « civilisation ».
L’instinct amoureux, l’apport passionnel se superposent, s’opposent, se complètent, s’organisent en une sorte de conflit organique, structurel avec l’amour « savant » conscient de lui-même et épris de sa propre démarche et dont il savoure chaque étape.
La passion brutale qui peut s’avérer dramatique et se complaît peut-être à l’être ou à le devenir dans le cadre de cet étrange masochisme qui s’introduit parfois dans toute activité ou dans toute sensibilité humaine n’est pas étrangère à la cruauté dont elle aussi nous sommes parfois (ou volontiers) capables.
Il existe aussi un amour savant, souvent voudrait-il se voir rituel, qui pour être moins général et fréquent est très curieusement pérenne, variable et sujet à tous les caprices et à toutes les modes.
En faudrait-il inférer qu’il est là question d’un module d’inspiration et d’aspiration féminines ?
Bien sûr il est naturel qu’à chaque étape de la civilisation et à chaque époque certes le cérémonial amoureux, le rituel s’adaptent sans se métamorphoser, se complaisent et se plient à toutes les circonstances, de la proposition brutale aux approches successives de la « fréquentation » et aux raffinements de la séduction.
Face à un catalogue qui relève de chaque époque finalement, le penchant infini du Moyen Âge pour la féerie, le merveilleux et le rêve prirent alors leur essor, s’avérant à jamais d’autant plus inimitables qu’au fond, c’est lui qui les a inventés.
Les Cours d’Amour, ces tournois où les « champions » participants dédiaient aux dames leur performance comme les toreros encore avec la tête et la queue de leur adversaire, d’où les chevaliers courtois (ils ne l’étaient pas tous : le seigneur du lieu par exemple pouvait participer « librement » il s’agissait aussi d’un sport et d’un spectacle) partaient à la quête de prouesses ou au secours de la « Dame » de leurs pensées au service de laquelle ils s’étaient consacrés par amour, par devoir ou par rencontre fortuite ou miraculeuse, qui s’orientera d’une manière ou d’une autre au fil des épisodes ou aux progrès de l’imagination créatrice à davantage de caprices ou d’inventivité diabolique de la part de l’élue comme des circonstances. Pour en arriver à de véritables provocations comme Lancelot voué à la honte voire, paradoxe suprême, au déshonneur et au mépris (apparent ?) de sa Dame, mais à la preuve évidente de sa « cruauté » et à un souci certain de la montrer pour mieux faire état de son pouvoir. La vie moderne nous apprend encore le peu d’estime féminin en profondeur des faiblesses montrées par les hommes : à l’égard de ses pareilles essentiellement il est vrai.
Ces récits, ces imaginations, ces imaginaires étaient fréquemment élaborés, nous rapporte-t-on, au sein de sortes de jeux de Cour, des compétitions d’esprit et de paradoxes, de divertissements surtout, tournois et assauts verbaux d’esprits, de personnalités et d’éloquences imaginatives comme du simple plaisir de briller et de parader et peut-être tout ceci au service d’ambitions plus ou moins déguisées comme il est naturel en de tels lieux.
L’exemple le plus spectaculaire et des plus achevés se situe en Pays d’oc dans les grandes Cours de Poitou et d’Aquitaine, essentiellement cette famille de Poitiers, chez ces Plantagenêt qui se firent rois d’Angleterre dont la cour franco-anglaise de Henri II né au Mans en 1133, duc de Normandie en 1150 , comte d’Anjou en 1151 et devenu duc d’Aquitaine en 1152 en épousant Aliénor qui avait divorcé de de Louis VII et de la couronne de France . Auparavant, reine de France et sa plus puissante et importante vassale, elle avait vécu avec lui la Seconde croisade, ce qui n’était pas si évident de la part d’un descendant de cette dynastie peu portée à s’engager dans l’ « Aventure ». Nul ne saura jamais vraiment pourquoi tout ceci advint. Cette galante et aventureuse épopée apparemment ainsi jouée à la Cour de France, en Aquitaine et aussi à la seconde croisade et à celles-ci à leur tour posent-elles une énigme qui ne sera pas vraiment résolue, mais la genèse de cette guerre de Cent ans se trouve probablement là, où s’abîmèrent l’Europe occidentale aussi bien que le Moyen Âge, la Chevalerie comme les Troubadours et aussi que le destin de l’Europe se joua. Et que la modernité fut un jour en mesure de s’emparer de l’espèce humaine… Ces Grandes Dames exerçaient à plein leurs suzerainetés quand elles entraient en possession, mais elles savaient jouer aussi avec les Couronnes en dépit ou autour de la Loi salique.
Saluons au passage l’ombre gracieuse de Marie de Champagne, fille de France, de Louis VII et Aliénor d’Aquitaine qui commanda à Chrétien de Troyes le roman de Lancelot du Lac, où l’austère et emblématique Reine Guenièvre épouse du roi Arthur prend un curieux virage de belle et romantique Dame enlevée et disposant les plus curieuses embûches dans les pas de Lancelot lancé vers sa délivrance. Chrétien était un Trouvère, qui faisait partie de son entourage. Dans son préambule il se plaint discrètement d’avoir obéi aux injonctions de la Princesse pour en dessiner malgré lui l’intrigue qui manque ostensiblement à la stricte obédience religieuse, tout en réalisant la jonction des langues d’oïl et de l’inspiration « Courtoise » d’Oc pour en arriver au centralisateur vieux français. Clerc ou bien proche de l’être lui-même use-t-il d’un peu de prudence vis-à-vis des autorités religieuses et de leurs bras séculiers ?
Qui régirait la France, emporterait la couronne, de l’Angleterre Plantagenêt, courtoise, féodale et quelque peu fantasque, cumulant les plus beaux, les plus fertiles et civilisés des fiefs de France du centre, du sud et de l’Ouest ou des Capétiens du Nord, titulaires de la couronne et relevant de la loi des Francs saliens qu’ils brandissaient comme une arme … ou se gardaient-ils de la mettre en avant selon les circonstances, qui prohibait pour le titre royal toute succession autre que de progéniture masculine, mais ils restaient friands d’épouses héritières de fiefs ! Celles-ci jouaient-elles leur souveraineté pour l’aventure personnelle et la destinée d’une Reine de France. Oubliaient-ils vraiment que la vraie tradition féodale, la même loi sans doute soumettait la dite succession à l’élection du Roi par ses pairs, les « Grands féodaux » ?
Ainsi élue en la personne d’Hugues Capet à la veille de l’an Mille, la dynastie avait réussi à y échapper en couronnant ses héritiers successifs du vivant de leur père.
Elle utilisait pour ce faire ses légistes et ses juristes, s’appuyait sur les milieux économiques nouveaux de la bourgeoisie de commerce parisienne, bref jouait la société de l’avenir contre celle du passé en voie de s’abolir. Les grands vassaux s’attardaient dans leurs conflits, leurs alliances et leurs intérêts locaux et laissaient les Rois de France centraliser leur territoire, qui n’intervenait dans leurs affaires qu’à coup sûr, épousant des héritières somme toute consentantes à un destin personnel de Reine de France. Le cas était fréquent en ces temps troublés de guerres, de pèlerinages et de croisades ; nombre de grands seigneurs étaient aussi des preux valeureux et des guerriers chevaleresques avant toute chose assoiffés de prouesses et de butin, de rêves d’Orient et de promesses de salut éternel comme de vies amoureuses. Des hécatombes survenaient ainsi parmi eux..
De croisades, la monarchie capétienne des premières générations usait peu. Quand elle s’y mit, était-ce que notre héritière de l’Aquitaine, cette belle, intelligente et ambitieuse petite-fille du Comte de Poitiers troubadour Charles IX parfaite Dame et Souveraine, héroïne de roman courtois se trouvait Reine de France, épouse depuis 1137, d’un Louis VII dont l’on dit qu’il était faible de caractère, mais qu’en sait-on, très épris d’elle, mais auquel, après (neuf) ans de mariage. Elle initia la Cour de France aux idées romantiques et romanesques à la mode, sortait du Palais pour visiter la foire du Lendit et ne manquait pas d’aventures galantes murmuraient les jaloux qui l’en gratifiaient, elle ne lui avait donné qu’une fille après fort longtemps et de nombreux épisodes, cette Marie de Champagne même qui daignera inspirer Chrétien.
Les caprices de Guenièvre qu’elle lui « imposa » alors narrés par Chrétien « dépassant disait-il ses convictions » n’étaient-ils pas ceux mêmes de sa mère, pas si loin dans leurs contours que ceux dictés aux personnages-héros de Sacher Masoch un peu plus tard ?
(Saint) Bernard de Clairvaux lui avait bien promis un enfant, mais cela n’avait encore été (qu’) une fille insistait tant et intriguait en faveur d’une nouvelle croisade (la seconde).
La mode avait si bien triomphé que cette seconde croisade, après le succès de la première qu’elle entendait parfaire, fit un « tabac ». Tout le monde voulut s’y embarquer y compris bon nombre de « nobles et puissantes Dames » décidées à suivre le couple royal qui avait donné l’exemple et Aliénor devra ainsi être la seule Reine de France à avoir vu Constantinople.
Tout peut-être s’est-il joué alors dans cette « aventure » qui avait intégré qui sait dans une sorte d’épopée romanesque en écho à la mode courtoise entre cette Reine de France, la plus grande féodale du Royaume qui suivait son époux à la guerre, y transportait la Cour à l’instar du Roi Arthur et Guenièvre aux blonds cheveux.
Qu’advint-il alors qui se brisa, rêve entier ou réalité sordide, jalousie et vile querelle ? Nul en fait n’en sut jamais rien, mais c’est ainsi que le couple royal se sépara, qu’un divorce intervint, chose peu courante alors, ne fallait-il qu’il s’agît du couple le plus puissant de la chrétienté, rien moins qu’un conclave pour en décider ( un cousinage tarabiscoté aurait interdit l’union), qu’elle échoua
devant Damas et que deux ans plus tard Aliénor d’Aquitaine épousât Henri II de son côté roi d’Angleterre, lui apportant cette Aquitaine et ce Poitou et cette Champagne qui devaient à long terme allumer une « Guerre de Cent ans » retardée par Philippe-Auguste, modeler le destin de l’Europe occidentale et de sa civilisation tout entière et donner fin au Moyen Âge, à la féodalité et à toute cette fragile, mais révolutionnaire civilisation qu’elle avait portée dans son sein et dont nul ne saura jamais si ce qu’elle tint entre ses mains releva du rêve ou de la réalité ?
De l’autre côté, mais en était-il si loin, le bréviaire de l’Amour courtois tentait d’établir ses versets en élaborant, toujours selon ce rite dorénavant consacré du concile mondain, de l’éloquence salonnarde, spirituelle et de sa casuistique le code de l’itinéraire et du comportement amoureux.
Le Roman de la Rose, de Béroul puis Thomas, les déclinaisons que l’on en respire dans tant de « courtes épopées » d’alors, de contes et de lais, lointains échos dans leur démarche des pastorales relayaient cette tonalité de préciosité mondaine qui poursuivait imperturbablement son chemin dans les romans de Melle de Scudéry voire « la Princesse de Clèves », la Carte du Tendre de l’Hôtel de Rambouillet pour trouver son déclin à peu près définitif il le semble : caricature « réaliste » et la fantastique et fantasmatique « Leçon d’Anatomie » selon Marcel Proust admirant chez Morand, « Minotaure des cœurs féminins la métamorphose imposée par la modernité.
Mais jadis, dans le même temps de cette fantasque parade, alors avaient souffert Héloïse et Abélard vivant dans leur chair, leur vie et leur idylle le cruel parcours de l’amour le plus « courtois » et le plus total.