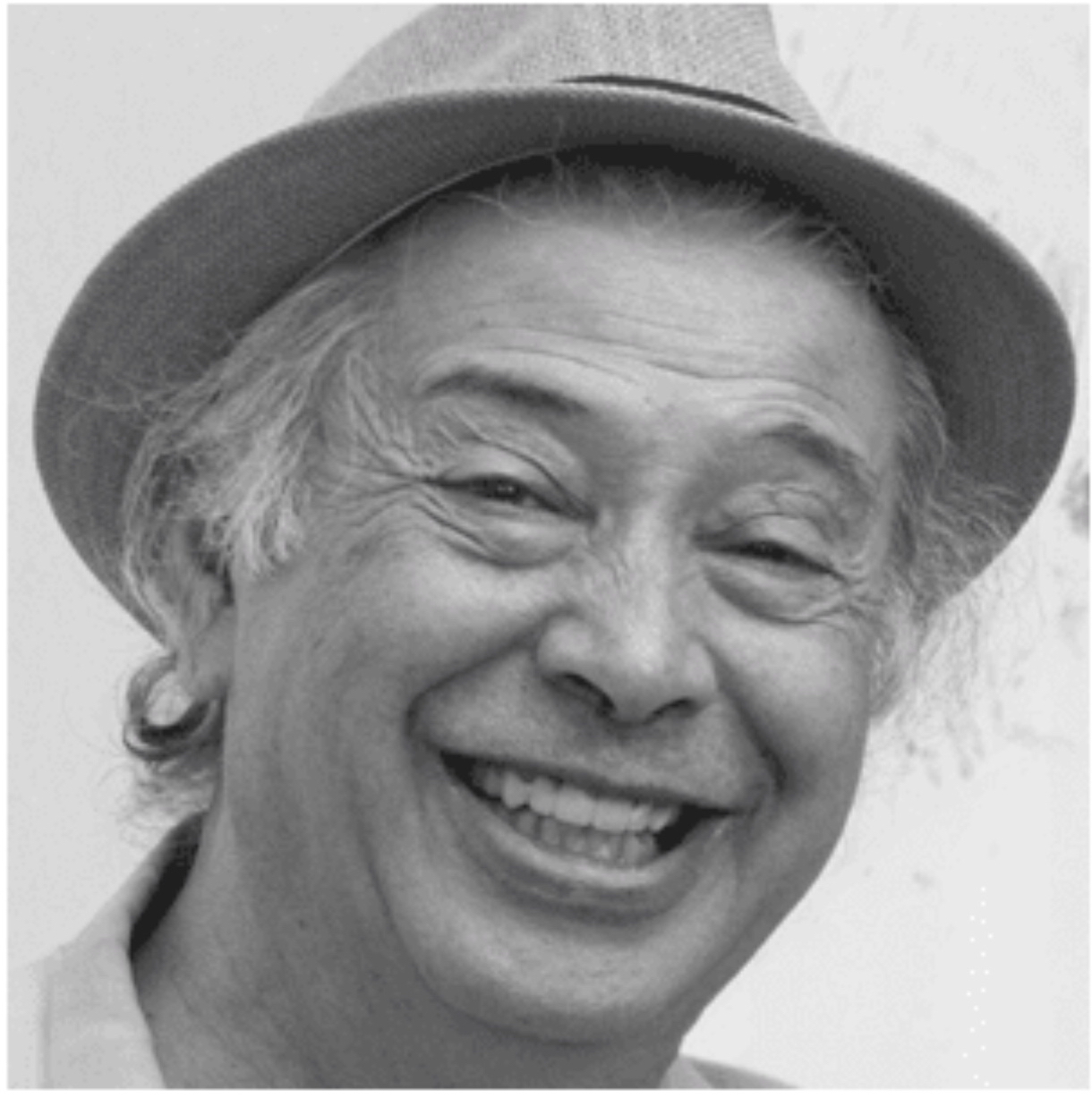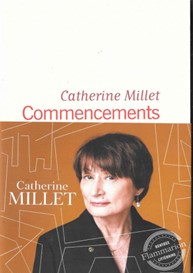Anachronique du flâneur N° 29
Par Marc Albert-Levin
Par quel mystère certains fragments de ma mémoire survivent-ils à tout ? A l’épouvantable entonnoir-éteignoir du temps qui me rend (est-ce un atout ?) indifférent à tout ? A l’invasion des punaises de lit et aux pulvérisations chimiques qu’elles entraînent après avoir contraint mes amis Caramel Louis et Sanfroid Gitan à mettre tous mes livres et papiers dans des cartons … Pourquoi certains petits bouts de papiers parviennent-ils à ressurgir tout d’un coup sous mes yeux alors qu’y restent accrochés (pour moi, mais sans doute pour moi seul tant que je ne prends pas la peine de vous les décrire) tant de souvenirs bien vivaces ?
Je quitte la maison pour un hôpital où je sais que je vais passer quelques jours et j’attrape au vol un livre de Hart Leroy Bibbs publié chez Christian Bourgois en 1969. Pourquoi Bibbs ? Parce que son livre me tombe sous la main et que c’était un personnage haut en couleur, Bibbs ! (Je l’entends déjà qui m’engueule. « Qu’est-ce que ça veut dire « haut en couleur » ? Une façon hypocrite de dire que je suis un « homme de couleur » ?) Comme le chante et le danse si bien James Brown « I am Black and I’m proud ! (Je suis Black et j’en suis fier !) »
J’avais traduit quelques nouvelles de Bibbs pour Christian Bourgois, l’éditeur, du temps où Leroy était l’amant de Jacqueline Ranson, directrice de la Galerie Furstenberg, sur cette jolie place à Paris, juste à côté du Musée Delacroix. Ils nous avaient invités, Barbara et moi, dans la maison où ils vivaient à Tourettes-sur-Loup, en Provence. Que dit de Bibbs, la pierre tombale la plus légère qui soit, la mémoire collective accessible à tous et partout sur internet ?
Hart Leroy Bibbs est né à Kansas City, Missouri, USA, en 1930, décédé en 1994. Cet autodidacte a d’abord été journaliste puis photographe, spécialisé dans le milieu du jazz, avant d’entamer sa propre recherche artistique. Il est peintre, sculpteur, et, bien-sûr, poète musicien.
Bien sûr ! Mais « Camétude », son petit livre de moins de cent pages, est devenu, au mois de mai 2022, cinquante trois ans après sa parution en août 1969, bien difficile à lire. N’en prenons pour preuve que le dernier paragraphe :
« Allons, viens, pose tes boucles blondes et soyeuses entre mes longues cuisses noires …Baisse tes grosses miches blanches bien comme il faut…… bien rouges et prêtes pour une autre série de coups. Des coups ! Espèce de tapis à bites ! » …
La ligne qui suit montre l’inanité de la traduction (Mary Beach et Claude Pelieu).
« Qui pourrais-je caroubler sinon toi ? »
Caroubler est un mot inventé par le traducteur. Cela ne renvoie qu’à l’arbre exotique, le caroubier et son fruit la caroube. Est-ce que la caroube est destinée à remplacer la carotte qu’Henry Miller introduit dans le vagin d’une de ses amantes en lui disant « C’est le doppelgänger de ma queue » ? Miller raconte cela dans un de ses « Tropique », celui du Cancer ou du Capricorne, je ne sais plus.
Zéglobo Zéraphim, mon double démoniaque, n’hésite pas à rappeler sans pudeur qu’à quatorze ou quinze ans, il s’enfermait pendant des heures dans les toilettes de l’appartement qu’il habitait, rue du Faubourg Poissonnière à Paris, au grand dam des autres membres de sa famille quand ils avaient besoin des toilettes. A vrai dire, Zéraphim ne lisait Henry Miller que d’une main, l’autre étant trop occupée à calmer l’excitation suscitée par la franche description qu’il y trouvait des choses du sexe !
Doppelgänger ? Ce mot survivait dans ma mémoire sans que je sache très bien ce qu’il voulait dire. Heureusement, Internet vient à mon secours:
« Figurant dans de nombreux folklores et croyances, notamment dans la mythologie germanique et la mythologie nordique, le doppelgänger se présente toujours comme une copie, un double d’un individu ou bien sa version alternative souvent maléfique. »
J’ai retrouvé le passage d’Henry Miller, dans « Tropique du Capricorne » et horreur, malheur et consternation ! Ce n’est pas Miller lui-même qui insère une carotte dans le vagin de son amante. C’est Curley, un jeune voyou dont Miller relate, non sans admiration, les exploits avec une certaine Valeska …
« Quand le diable devient vieux, il se fait ermite »
J’en veux pour exemple Henry Miller qui, après avoir écrit à la première personne des aventures sexuelles audacieuses, voire inédites pour son temps, drague dans un métro aux heures d’affluence, exhibitionnisme dans Central Park, est devenu un vieillard qui à 80 ans s’est épris d’un amour fou pour une jeune et belle actrice qui porte le nom prédestiné de Brenda Venus. Il lui écrivit jusqu’à sa mort, à l’âge de 89 ans pas moins de 1500 lettres, parfois trois ou quatre par jour.
D’Henry Miller aussi certains n’ont longtemps voulu retenir que la franchise concernant ses aventures sexuelles. Mais on oublie trop souvent qu’il fut un aquarelliste de talent qui à un moment particulièrement désargenté de sa carrière vendit ses aquarelles par correspondance au prix d’un dollar pièce. Il a eu cette phrase magnifique dont tout véritable peintre reconnaîtra la justesse : « To paint is to love again » (Peindre c’est aimer à nouveau). Pour preuve cette reproduction tirée d’un calendrier édité en 1994 par une société des amis d’Henry Miller située à Périgueux.
 Henry Miller : aquarelle, 1965.
Henry Miller : aquarelle, 1965.
Une des caractéristiques les plus mystérieuses du temps est que, rien qu’en passant, il est parfois capable de changer de jeunes fous en vieux sages, riches en conseils fondés sur leur expérience personnelle.
Un autre exemple de cet assagissement est celui de Catherine Millet, que son livre « La vie sexuelle de Catherine M. » a rendue mondialement célèbre. Son plus récent ouvrage « Commencements » (Flammarion 2022), est remarquablement bien écrit et offre une description minutieuse et vivante du monde de l’art tel qu’elle l’a connu à ses débuts. Non seulement sa mémoire visuelle et auditive est excellente, mais elle est quasiment dotée d’une mémoire kinesthésique. Son évocation de Georges Boudaille, par exemple, qui fut notre chef de rubrique dans la section « Arts » des « Lettres françaises » est saisissante de justesse. Elle le ressuscite en quelques mots en le disant « bonhomme, irascible et caoutchouteux. … Il avait la manie de passer sur tout le bas de son visage un index et un annulaire qu’il avait longs et épais et avec lesquels il manipulait toute cette matière souple. (p. 138)»
L’équipe de « Cimaise » la revue fondée par Jean-Robert Arnaud et John Franklin Koenig, dans laquelle j’avais rencontré Georges Boudaille lorsqu’il y collaborait, comprenait Michel Ragon, grand défenseur des peintres abstraits de la Jeune Ecole de Paris (Atlan, Poliakoff, Martin Barré et James Guitet, ces deux derniers originaires de Nantes comme lui) ; et Pierre Restany, grand inventeur du « Nouveau Réalisme », (défenseur d’Arman, César, Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Raymond Hains, entre autres). A coté d’eux, Boudaille était un peu considéré comme l’idiot du village, le dernier de la classe. Il avait commencé sa carrière journalistique en écrivant dans des revues de voyage et ses articles brillaient surtout par leur absence de style. Pour ma part, il me faisait penser au N° 1000 de la série noire, un roman de Jim Thomson traduit par le directeur de la collection, Marcel Duhamel, dont le titre, dans ma mémoire, était « Le shérif de Plouc-ville ». En laissant toujours les autres prendre à sa place les décisions importantes, il parvenait aux positions les plus hautes dans la société. Mes efforts pour retrouver ce livre exhument un autre titre et un récit sensiblement différent : las des humiliations et des railleries dont il a été l’objet, le shérif devient un tueur en série dont aucun remords n’atténuera plus la fureur meurtrière. Quel que soit le moyen employé, Boudaille parvint bel et bien aux fonctions les plus élevées dans le monde de l’art. Il fut pendant des années le principal responsable de la Biennale de Paris.
En 1971, je vivais en Haïti, et j’avais conçu et préfacé, pour le galeriste Georges Nader, un petit catalogue bilingue intitulé « Art contemporain haïtien, Contemporary Haitian Art. » J’avais alors proposé à Georges Boudaille d’exposer un tap-tap au musée d’Art moderne, dans le cadre de la Biennale. Les tap-taps sont des taxis publics, des camionnettes agrémentées de structures multicolores en bois peint, dont les pare-brises sont enrichis de proverbes. Je me souviens en avoir photographié un qui s’appelait « Voici Dada ». Dada, dans ce cas, n’avait rien à voir avec le mouvement du même nom. C’était probablement le diminutif du prénom d’un conducteur-propriétaire s’appelant David.
Déjà en 1969, pour louer la salle de la Mutualité à Paris et y organiser un concert d’Ornette Coleman, Barbara Summers et moi avions créé une association que nous avions appelée D.A.D.A. (pour la Diffusion des Arts Divers Afro-américains.)
Tap-tap est peut-être une onomatopée décrivant le bruit que font ces camionnettes peintes en se déplaçant sur des routes crevassées et caillouteuses. Ce sont de véritables tape-culs précipitant souvent les gens qui s’y entassent les uns sur les autres. Mais ce sont indéniablement des œuvres d’art. Si la projection d’un gravier a créé des fêlures sur le pare-brise, le conducteur-propriétaire du tap-tap fait peindre des fleurettes sur les fêlures. Et sur le toit il n’est pas rare qu’il y ait des voyageurs supplémentaires avec parfois des poules et des cabris, arrimés à des pyramides de bagages. Je m’étais demandé s’il fallait exposer un tap-tap avec ou sans ses passagers ? George Boudaille avait résolu la question en me répondant, par télégramme. Non pour me dire qu’un tel projet (l’exposition d’un tap-tap au musée d’art moderne de Paris) était trop couteux ou irréalisable. Mais que malheureusement ma proposition lui était parvenue trop tard, en dehors des délais d’inscription réglementaires.
Villa bell », vers 1980, 42 x 51 x 12 cm.
Acquis par M. A.-L. en salle des ventes, Hôtel Drouot Paris le 22.10.2022. Photo Leila Bousnina.
Lambert Bonem : « Tap Tap Jacmel Chérie Villa bell », vers 1980, 42 x 51 x 12 cm. Acquis par M. A.-L. en salle des ventes, Hôtel Drouot Paris le 22.10.2022. Photo Leila Bousnina.
En 2001, Catherine Millet avait eu la gentillesse de me demander ce que je pensais de son projet d’écrire « La vie sexuelle … » Devant un pot, à la terrasse du bistrot « Le Père Tranquille », dans l’immeuble même où j’avais domicilié notre association « Le Chef d’œuvre inconnu », rue Rambuteau, au cœur des Halles, je l’y avais vivement encouragée. Je lui avais dit qu’une fois ce livre accouché, elle en écrirait beaucoup d’autres qui parleraient de tout autre chose. Prédiction avérée. Mais pour bien des lecteurs, elle continue à traîner ce livre comme une casserole alors même qu’elle s’en est elle-même depuis longtemps largement détachée. C’est le cas de Frédérique Zahnd que j’ai rencontrée en septembre 2022 à « La lucarne des écrivains » au 115, rue de l’Ourcq 75019 Paris. Cette auteure a publié, aux éditions « Unicité » « Autopsie d’un best seller », sous-titré « Le substrat catholique dans ‘La vie sexuelle de Catherine M. ». Cette dame très b.c.b.g. (bon chic bon genre ou bougrement catholique même si bien gaulée, au choix) qui vit en Suisse, voit dans le livre de Catherine « un authentique chef-d’œuvre qui donne sa forme aboutie à l’esprit d’une époque. »

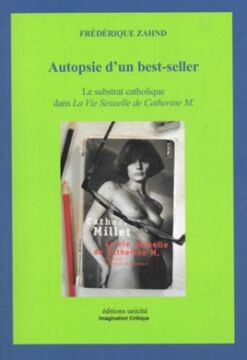 La couverture du livre, en posant sur la photo une paire de lunettes et des crayons,
La couverture du livre, en posant sur la photo une paire de lunettes et des crayons,
les outils de cette « autopsie » littéraire, défigure une jolie photo prise à la fin des années 1960 par le galeriste Daniel Templon.
« Commencements » rend aussi justice au partenaire de ses débuts, Daniel Templon et au rôle important qu’il a joué dans sa vie autant que son introduction dans le monde de l’art. Elle l’a consulté pour écrire le livre, lorsque sa mémoire lui faisait défaut.
Pour revenir à ce « substrat catholique » dont parle Frédérique Zahnd, à la première lecture de « La vie sexuelle de Catherine M. », il m’avait aussi frappé, notamment le désir sincère de Catherine dans l’enfance, de devenir une sainte.
Il faut, de toute façon, une certaine dose de sainteté pour vouloir absolument soulager la misère sexuelle de tous les êtres que l’on rencontre. L’aspiration de Catherine à la sainteté avait été immédiatement anéantie [1]par la réponse idiote d’un curé qui lui avait dit que vie sexuelle et sainteté étaient incompatibles. Sa prohibition par le christianisme change la sexualité en une obsession permanente. Elle suscite un sentiment de culpabilité constant, entretenu par la menace de l’enfer et la peur du péché mortel. Une des choses qui m’ont personnellement attiré vers le bouddhisme de Nichiren, est qu’il ne comporte pas d’interdiction ou de suppression des désirs. Il énonce un principe « Les désirs, les illusions et les souffrances (les trois notions se retrouvent dans le seul mot de bonno) conduisent à l’illumination » en japonais bonno soku bodaï. La satisfaction des désirs n’est pas le but du voyage mais elle est le combustible dont on a besoin pour avancer, pour aller plus loin. On trouve, dans le 7e chapitre du Sûtra du Lotus, « La Parabole de la Cité illusoire ». Alors que le Bouddha les guide vers une terre aux trésors lointaine, (l’illumination), à mi-chemin, fatigués les voyageurs se découragent et veulent rebrousser chemin. Alors, grâce à ses pouvoirs transcendantaux, le Bouddha fait surgir une cité de rêve dans laquelle ils peuvent assouvir tous leurs désirs : manger des mets raffinés, se désaltérer en buvant des boissons délicieuses, se reposer dans des lits confortables et des draps finement brodés. Mais une fois qu’ils sont pleinement repus et reposés, le Bouddha fait disparaître cette ville illusoire. Il leur indique que ce n’est pas le terme du voyage mais que le véritable but n’est plus très loin : c’est l’état de Bouddha, un bonheur qu’aucune circonstance extérieure ne peut altérer.
Je reviens à ce dernier paragraphe du livre de Bibbs traduit par « Camétude ». Le titre en anglais en était « Diet book for junkies » (Livre de régime pour drogués). L’éditeur Christian Bourgois l’avait publié en août 1969, un an et quelques mois après mai 68. « La philosophie dans le boudoir » du divin marquis Donatien Alfonse François de était parue en livre de poche trois ans plus tôt dans la collection « Liberté » chez Jean-Jacques Pauvert. Ce pamphlet bel et bien prononcé en pleine époque révolutionnaire était sous-titré « Français encore un effort si vous voulez être républicains ». Sade y réhabilitait l’inceste, qui devrait selon lui être la règle dans une société fondée sur la fraternité, le vol qui corrigeait l’injustice du destin qui fait naître les uns richissimes et les autres miséreux, la calomnie dont ceux qu’elle visait à tort ne pouvaient ressortir que plus forts. J’en avais rendu compte dans « Les Lettres françaises » sous le titre « Sade en liberté dans votre poche ».On croyait dans ces années là qu’il y aurait une nouvelle façon, plus libre, de vivre la sexualité.
Ces dernières lignes de « Camétude » personne ne les publierait de nos jours, au début du XXIe siècle, dans une époque qui, après le Sida, les scandales de pédophilie ecclésiastique, Me too, etc. est redevenue pudibonde.
« Où vas-tu ? Remets ta tête entre mes cuisses. O.K. O.K. Je vais te peler le cul et il vaudrait mieux ne pas essayer de me mordre. Si cette salope croit que je vais fermer les yeux et ronronner et ne pas voir ce qui se passe dans le monde … Qu’elle aille se faire foutre ! Zap ! a terminado. »
L’érotisme, tout comme la poésie, passe mal par la traduction. Je me souviens de « L’Empire des sens » un film japonais de Nagasa Oshima, projeté rue Saint-André des Arts, à Saint-Michel en 1976. J’étais allé le voir à plusieurs reprises. On écoutait religieusement des onomatopées en japonais auxquelles on ne comprenait rien, tout en lisant attentivement les sous-titres en français. Mais un jour l’opérateur s’est trompé de bobine et les spectateurs ont entendu soudain une version doublée en français : « Bouge ton cul salope ! » et autres expressions d’une semblable vulgarité. Cela brisait totalement l’atmosphère de tension créée graduellement par le film. Les deux personnages principaux (un bourgeois japonais marié et sa bonne) évoluent d’abord dans un quotidien sans histoire. Mais on les voit s’enfermer peu à peu dans une relation sexuelle qui devient exclusive, obsessionnelle et qui connaît une fin tragique. En entendant la bande son française, les gens se sont levés et ont quitté la salle.
Internet m’apprend aussi que Bibbs avait écrit à quatre mains avec Ted Joans un poème intitulé « Double Trouble ». Mais Ted Joans est une autre histoire. Ted, qui avait proclamé à plusieurs reprises « Le Jazz est ma religion », avait été très lié avec André Breton. J’ai insèré, dans mon collage pour le stand de « La Lucarne des Ecrivains » au Marché de la Poésie, une photo trouvée sur le net d’André Breton avec Ted Joans dans l’atelier de Breton à Pigalle. Au mur, la célèbre toile de Max Ernst « Dancer /Danger ». Ted avait invité Barbara Summers à rendre visite avec lui à Elisa Breton, la troisième épouse d’André, dans cet atelier du 47 rue Fontaine qu’une vente aux enchères à Drouot rendit célèbre en avril 2002. D’origine chilienne, Elisa était collagiste, elle aussi. Ah comme je regrette de ne plus pouvoir demander plus de détails sur cette visite à Barbara !
Lors d’un de ses séjours à Paris, Dexter Gordon, le célèbre saxophoniste ténor qui joue le rôle central dans « Autour de minuit » le film de Bertrand Tavernier, avait rencontré Barbara. Dexter lui avait dit qu’elle ressemblait à Billie Holiday. C’était vrai. Vivre avec Barbara à ses côtés, c’était être à tout instant en connivence avec l’élégance et la beauté.
Zéglobo Zérapim : « A fleur de peau », collage 2022. 30 x 40 cm. Barbara Summers et la couverture de plusieurs livres dont elle est l’auteure : « I Dream a World: Portraits of Black Women Who Changed America » « Skin Deep », « The Price you pay ».
Zéglobo Zéraphim, Collage, 9.06.2022, exposé au stand de « La Lucarne des Ecrivains » au Marché de la Poésie, Place Saint-Sulpice à Paris.
J’ai aussi retrouvé, dans un catalogue du couturier et créateur de modes japonais Issey Miyake (East meets West, publié en 1978), une très belle photo de Barbara, que je ne connaissais pas. Je l’ai incluse dans le collage accroché au Marché de la poésie du 8 au 12 juin 2022, Place Saint-Sulpice.. Autres éléments du collage : Marc Albert-Levin photographié en 1967 par Larry Fink à la Castalia Foundation, Milbrook, upstate New York où Timothy Leary avait installé sa League for Spiritual Discovery (Ligue pour la Découverte Spirituelle) L.S.D. Et en bas, à gauche, Timothy Leary et Allen Ginsberg, également photographiés par Larry Fink.
On voit encore Hart Leroy Bibbs, tout au début de « Autour de minuit » le film de Bertrand Tavernier dont la musique avait été composée par le pianiste Herbie Hancock. Bibbs y joue, sans difficulté aucune, l’un des rôles derrière lesquels il s’était souvent caché au cours de sa vie, celui d’un drogué alité.
You Tube conserve aussi quelques souvenirs de Ted Joans qui récite, par exemple, un bref poème très charmant.
« Si vous voyez un homme qui descend la rue en gesticulant et en se parlant fort à lui-même, ne partez pas dans la direction opposée, au contraire, allez vers lui. Car c’est un poète, et il n’y a rien à craindre d’un poète, rien d’autre que la vérité. »
J’insère l’autoportrait de Bibbs dans un collage de mai 2022, réalisé à l’hôpital Bretonneau (!) Son visage tronqué, semble plutôt patibulaire, mais il est dédicacé « To Mark & Barbara, Uhuru ! » (qui veut dire liberté en swahili).
Hart Leroy Bibbs, autoportrait, 1970
Dans les années 1980, j’avais traduit pour « Jazz Hot » un poème de Bibbs sur la musique de Count Basie intitulé « Count down » (Compte à rebours). J’ai prêté « Camétude » à Yves-Robert Viala, qui me le rend en disant qu’il n’y comprend rien. A vrai dire, la poésie est intraduisible et celle de Bibbs moins traduisible qu’aucune autre. Il y a les rythmes et les sonorités, de l’argot afro-américain … Mais voici « Compte à rebours » (ne me demandez pas pourquoi ni comment, tant d’années plus tard, dans une chambre d’hôpital, j’en ai le texte imprimé sous les yeux).
Plus faible que ma vue oblique, le goût pourtant l’exige
Maintenant aujourd’hui ou maintenant hier
Pour lier la mémoire, fixer le souvenir, interdire l’oubli
Car tout autour de nous c’est une polyphonie de sons mauvais.
La tragédie déploie largement ses filets – Frappe !
Une grande famille américaine, cœur déchiré, en larmes,
Compte parmi ses pertes jeunes proches et parents
Et dans son désespoir maudit le destin qui s’en moque.
Chaque jour. Chaque jour, guerre et faiseurs de guerres.
Bibbs pensait sans doute à la guerre du Vietnam contre laquelle, au cœur même de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, Martin Luther King s’était élevé. Au risque de déplaire (ce qui n’avait pas manqué) à Lyndon B. Johnson, grand va-t-en guerre s’il en fut. L.B.J. pour sa part, ne voyait aucun inconvénient à ce que de jeunes Noirs aillent trucider des Vietnamiens ou bombarder leurs forêts au napalm pour l’amour de la patrie : cette Amérika qui ne leur avait même pas encore accordé le droit de s’asseoir à l’avant du bus.
« Monte et descend les gammes, Count, de solides tons entiers
Et branche-nous par intervalles au mystère universel.
Frère chinois au frère américain parla
Sous les auspices de l’orchestre de chaque famille.
Ils ont prié ensemble et swingué le même refrain.
Mutuel respect et paix mutuelle.
Wei wu wei. »
Je trouve ces trois syllabes de chinois traduites par « La non-action consciente, la décision délibérée et par principe de ne rien faire, pour une bonne raison. » Mine de rien, en inscrivant ces trois syllabes énigmatiques, (du chinois !) Bibbs faisait allusion à l’un des principes majeurs du taoïsme, celui du non agir pour mieux s’harmoniser avec le flux de la vie, avec la voie (tao) universelle.
Des manuscrits de Hart Leroy Bibbs
Ici, je me dois d’insérer une preuve supplémentaire, une évidence irréfutable de l’amitié qui m’a liée à ce personnage étonnant qu’était Hart Leroy Bibbs. Il m’avait donné plusieurs manuscrits, des textes écrits en anglais à Paris, à la pointe de feutre noire sur des pages soigneusement datées et numérotées. J’en ai rempli tout un classeur que je me promets de traduire un jour.
.Il y a un manifeste pour lequel Bibbs avait forgé un mot valise « Manifesto Optksorption » (l’absorption optique ?, en tout cas sur la photographie), 1977, 1 feuillet.
. Il y a « Pas de jazz en Egypte », 1982, 11 feuillets que Gérald Arnaud et moi lui avions demandé pour « Jazz Hot ».
. Il y a « Free Jazz from Strange Fruit » (Libérez le Jazz de Strange fruit, cette chanson immortalisée par Billie Holiday, qui décrit ces fruits étranges que sont les corps des Noirs lynchés suspendus aux branches des peupliers d’une ville du Sud des Etats-Unis par un beau soir d’été), 1983, 16 feuillets. C’est l’histoire du saxophoniste Arthur Doyle, accusé de viol par deux touristes suédoises et qui ne fut libéré d’une prison française qu’au bout de six ans.
. Il y a « La maladie obscène » sous-titré « Il n’a pas pu se retenir », 1984, 5 feuillets : comment l’auteur, diabétique, logé chez des inconnus à Francfort pendant la foire du livre, parce qu’il s’est trompé d’étage, finit par pisser contre la porte des voisins du dessous.
. Il y a « Par for the course » (l’expression employée lorsqu’un parcours de golf est effectué selon le nombre de coups prévus), 1984, 9 feuillets. Le récit d’un concert du pianiste Mal Waldron au Centre culturel de Soissons, avec plusieurs mots écrit en français dans le texte : « Merde », « Maison seule », lorsque Bibbs demande à la serveuse du restaurant ce qu’elle a l’intention de faire de sa douce petite chatte après le travail, « Je m’en foutre » (ou quelque-chose d’approchant, précise Bibbs) prononcé par un opérateur de la régie lumière.
. Il y a « The hanging box » (la boîte suspendue) une nouvelle de 27 pages dactylographiées écrite en hommage à Chester Himes, faisant revivre les principaux protagonistes des romans de Chess, les deux détectives de Harlem, Ed Cercueil et Fossoyeur.
Ci-dessus, donc, un portrait que Bibbs avait fait de Barbara Summers bien des années avant qu’elle ne devienne l’un des mannequins les plus réputés de l’agence Ford à New York, et l’auteure d’un très beau livre sur la femme noire dans la mode « Skin Deep », titre que l’on pourrait traduire par « A fleur de peau ».
Etonnant comme une rencontre conduit à l’autre…
L’ami peintre Didier Meynard, voyant le tampon de Larry au dos de ces photos argentiques exhumées d’une vieille valise en peau de crocodile, m’a dit : «Je connais quelqu’un que cela intéresserait beaucoup » ! Il m’a fait rencontrer cet ami qui, en plus des anciennes photos, a retrouvé chez moi des textes oubliés : les épreuves, déjà composées chez Pauvert, de deux ébauches de livres qui devaient compléter « Un Printemps à New York » et « Tour de Farce ». Cela s’appelait « Le petit voyage LSD » et « Des mois en miettes ». La parution prochaine en avait même été annoncée dans « Les Lettres françaises » mais cette promesse n’avait jamais été tenue.
Une visite de Didier Meynard
Etonnante aussi l’insistance avec laquelle ressurgissent du passé certains fragments de mémoire oubliés ! Il y a donc eu d’abord une visite de Didier Meynard. J’admire le travail de Didier depuis des années et j’ai écrit sur ses œuvres récentes, un texte intitulé « D’excellents perchoirs pour la rêverie. » Ce sont des constructions en bois peintes et parfois suspendues qui me font penser aux vaisseaux spatiaux, évoqués par Sun Ra au cours de ces voyages musicaux interplanétaire qu’il proposait avec son « Arkestra ». « Nous voyageons de planète en planète ». « Si vous trouvez la Terre ennuyeuse, rejoignez la Compagnie Space Incorporated … »
Didier m’a fait rencontrer Daniel Azoulay. Daniel A. est un libraire chercheur, collecteur de manuscrits, d’œuvres d’art, d’archives et de livres rares, qui va désormais recevoir ses clients et ses amis au 15 de la rue Gay Lussac, non loin du Jardin du Luxembourg. Il édite des catalogues que par antiphrase il intitule « Actualités » alors qu’ils n’ont d’actuel que son intérêt constant et opiniâtre pour les documents d’une autre époque, riche en avant-gardes et en surprises littéraires ou artistiques. Non content de « faire l’article » de ce qu’il propose aux collectionneurs, aux musées et aux bibliothèques, en sélectionnant certains fragments, il fait, dans ses catalogues, une sorte de collage littéraire. Il va désormais exposer des peintres.
Scanreigh
L’exposition inaugurale de la galerie « Actualités », le 22 novembre 2022, sera celle de Jean-Marc Scanreigh, un peintre talentueux, relativement peu connu à Paris. Originaire de Marrakech, il s’est installé à Nîmes après avoir longtemps habité Strasbourg. Il a fait également quelques échappées remarquées, à New York.
Le travail de Scanreigh, bien que peu facile à décrire, a déjà su attirer les commentaires élogieux de grands écrivains, comme Gilbert Lascault, qui écrivait en 1989: « Ici, les fantômes facétieux farfouillent dans les fissures des façades … Les farfadets poursuivent en vain les assassins balafrés, les voleurs tatoués, les escrocs borgnes. »
Un an plus tôt Bruno Duborgel avait déjà écrit : « Fascination du morcelé, du déchiqueté. Eloge du rapiécé. Découpages, dépeçages, mises en pièces, bricolages de morceaux … »
En 2008, Jacques Jouet, (avec Jacques Bertin l’un des deux Jacques de la Galerie JaJa) romancier de l’Oulipo (ouvroir de littérature potentielle) écrivait au sujet de Scanreigh : « … il dessine, il colorie. Il étale, il ramasse, il découpe, il taille, il planche, il scie, il gratte, il frotte… Il entasse, il dissémine, il sème à tous vents. Il aime tous les vents. »
En 2022, c’est-à-dire hier, dans art-press, Philippe Ducat écrit de manière très juste : « On ne sait jamais très bien si ce qu’on regarde est figuratif ou abstrait, avec cette tendance à la déconstruction … » P. Ducat offre pour finir cette définition d’un tableau de Scanreigh qui vaut pour beaucoup d’autres œuvres d’art contemporain : « … une surface plane recouverte de couleurs en un certain désordre assemblées. » J’ajouterai que de ce fouillis de couleurs et de formes anguleuses s’imbriquant les unes dans les autres, émergent souvent des visages dont les yeux semblent obstinément fixer le regardeur. Cela m’inspire un conseil (à l’égard de tous, et pas seulement à l’égard de ceux que je ne pourrais pas voir en peinture) : Si vous ne les avez pas encore vus, allez vous faire voir par les tableaux de Scanreigh !
Scanreigh : « J’ai trouvé la solution » 2010. Technique mixte avec collage sur bois. (30 x 40 cm.)
Mylène Vignon : Collages et didascalies.
Didascalies ? Le mot a été forgé à partir d’un verbe qui, en grec ancien, veut dire « enseigner », « instruire ». Les didascalies sont donc des instructions, les indications de mise en scène qu’un auteur ajoute aux dialogues d’une pièce de théâtre. Elles sont souvent écrites en italiques et entre parenthèses. Par exemple (En aparte), (Seul), (Joyeusement), (Avec colère). Celles dont il est question ici accompagnent un joli livre d’un peu moins de cent pages de 7 x 24 cm, sur papier glacé. Ce sont de courtes notations, plus brèves encore que des haïkus, qui orientent la lecture des collages et facilitent leur interprétation. Un peu comme « La liberté n’est plus ce qu’elle était » formule qui fait écho au titre devenu célèbre d’un roman de Simone Signoret : « La nostalgie n’est plus ce qu’elle était ». La légende de certains collages semble un commentaire direct de l’actualité sanitaire : « Bonne nouvelle, la maladie régresse » ou « Fuyons cette médecine, elle n’y peut rien ». D’autres font allusion à un état d’esprit, invisible : « Je délire, je vois des âmes, elles m’emportent. » ou encore : « A mon prochain voyage, je saurai. »
Le livre s’appelle « Les Belles Canapéennes ». C’est une série de collages accompagnés de ces courts textes de Mylène Vignon. Il est édité par Alin Avila qui, avec le talent qui caractérise toutes ses publications, l’a très finement mis en pages. Pour la circonstance, Mylène a inventé un nouveau mot : « canapéennes ». Tout le monde connaît les Européennes, mais qui sont les Canapéennes ? Ce néologisme désigne des femmes condamnées au confinement en 2021, un cauchemar que même la science-fiction n’aurait pu prévoir. Tout à coup, elles ne pouvaient plus habiter que leur canapé. Mais leur imagination, comme celle de Mylène, n’en est pas pour autant restée immobile.
Dans un décor souvent floral, ces collages créent un climat onirique et offrent au regard une profusion de rideaux, d’oreillers brodés et de draperies. C’est un ouvrage de dame dans le bon sens du terme, dépourvu de mièvrerie autant que de grossièreté Ce n’est plus, selon la formule chère à Isidore Ducasse « la rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table de dissection » C’est celle de fauteuils et de canapés que Mylène découpe et colle sur des fonds de couleur unie et qu’elle associe à des visages féminins souvent beaux et sereins.
A gauche, la page de couverture.
A droite l’un des collages accompagnant le tirage de tête 2021, 15 x 21 cm. Coll. M. A.-L.
Un collage de Mylène Vignon est entré dans la collection des objets pour lesquels j’ai une affection toute particulière. Il entoure d’une couronne de fleurs le visage d’André Breton, dont la dernière épouse, Elisa, comme je le rappelais plus haut, était elle aussi collagiste. Avec Jacqueline Lamba, une artiste de grand talent. Breton eut une fille, Aube Breton-Ellouët, qui signe également de très beaux collages. J’en avais vus plusieurs exposés à la Galerie 1900-2000, rue Bonaparte, en avais déjà parlé dans ma 2e « Anachronique du flâneur ». («Anachroniques du flâneur 1-14 », p. 27. Saisons de culture 2017).
Il y a quelques années, à New York, j’avais rendu visite à ma très chère amie, l’historienne d’art Dore Ashton. Elle était à l’époque responsable de la faculté des Arts de Cooper Union. Lorsque que je lui ai dit que je faisais des collages, elle m’a répondu d’un ton que j’avais trouvé sévère : « Le collage a fait beaucoup de mal à la peinture ! » Peut-être bien, mais pour ce qui est de Mylène Vignon, le collage donne à son écriture de bien jolies couleurs !
Mylène Vignon, « Visions nocturnes » collage 2020, Coll. M. A.-L. Photo Leila Bousnina