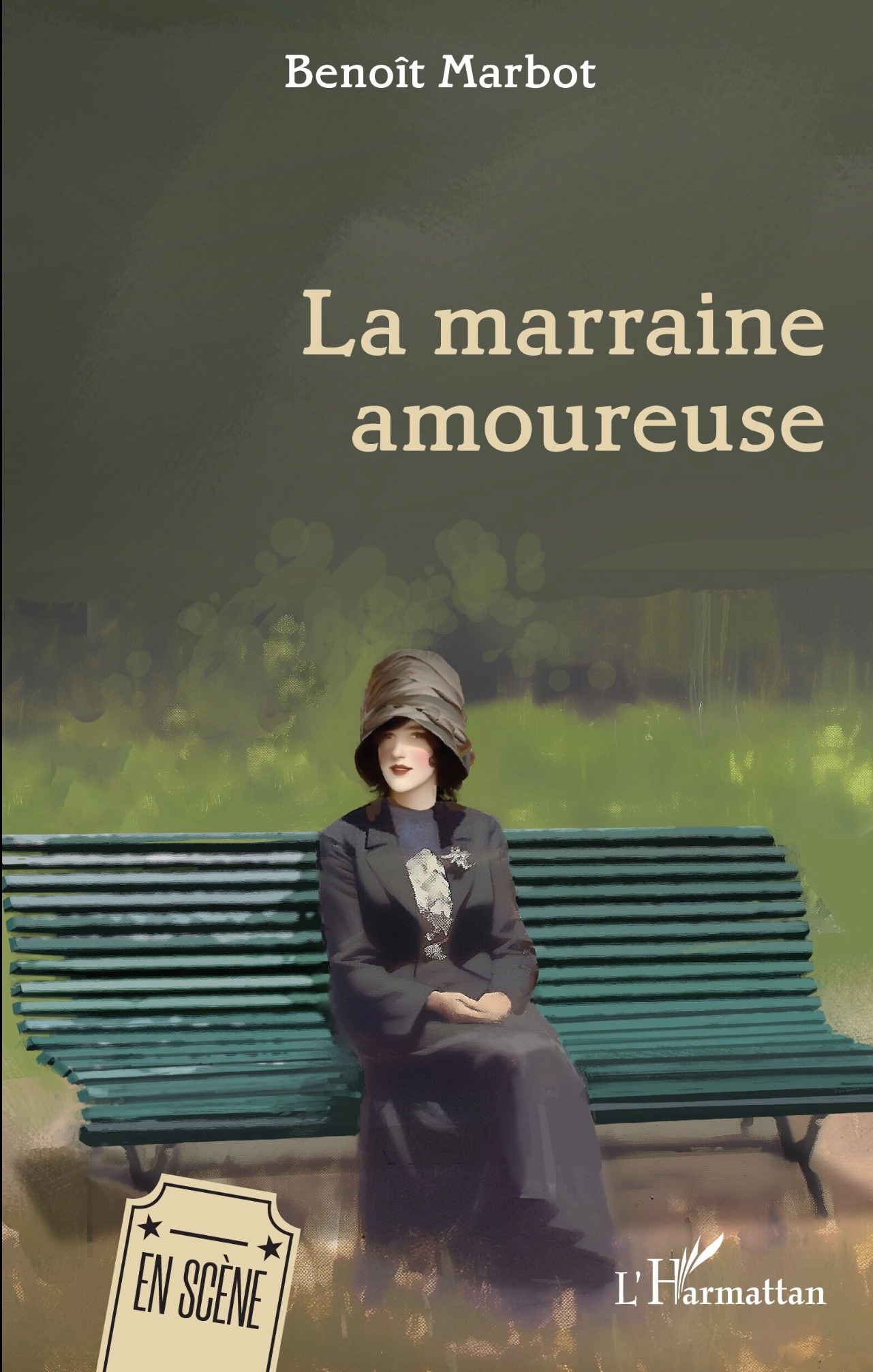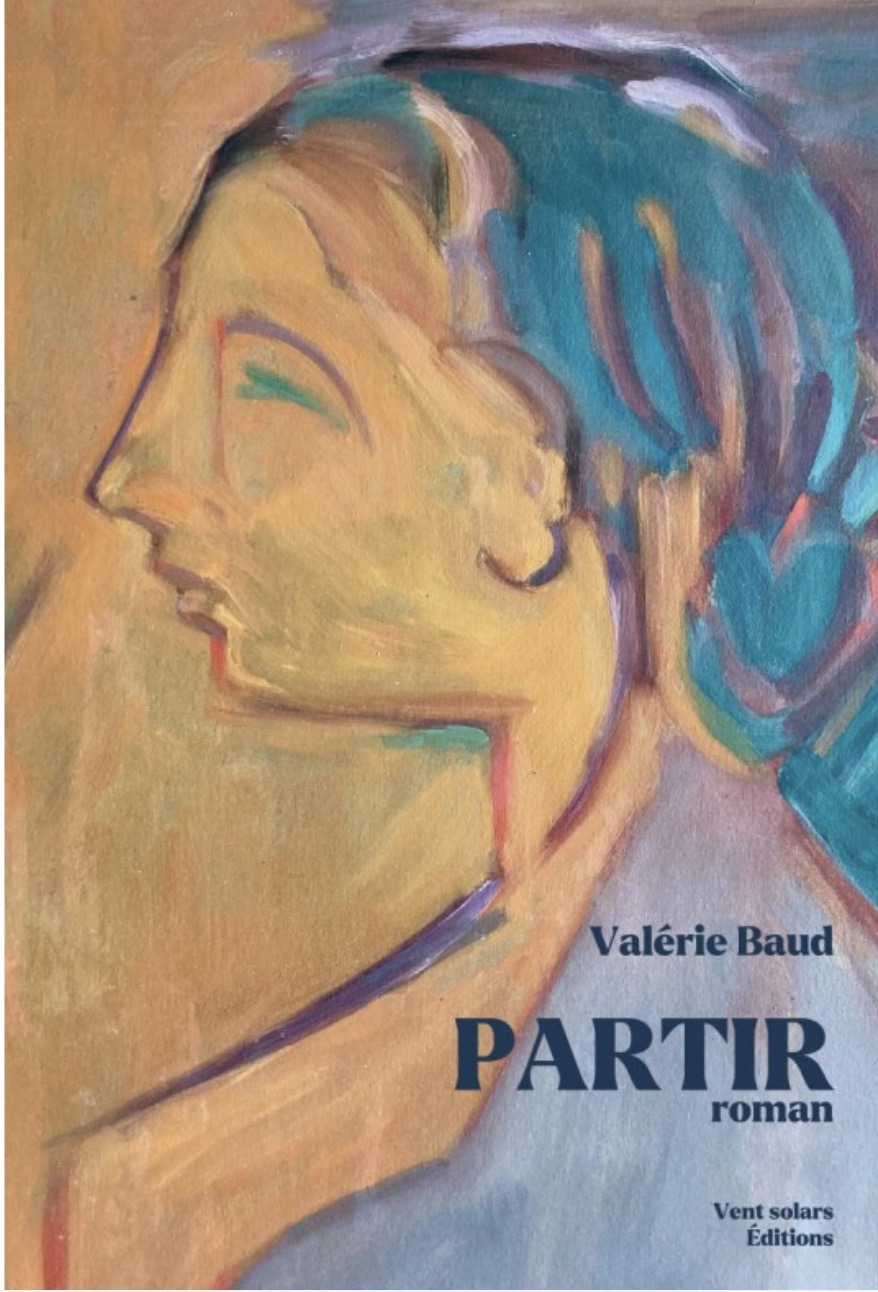Partir : le roman d’une insurrection douce et d’une trajectoire insoumise
Par Yves-Alexandre Julien
Dans un monde où les frontières s’érigent plus vite qu’elles ne s’effacent, où l’exil est réduit à un chiffre, un statut, un soupçon, Valérie Baud pour son deuxième roman publié par la maison d’édition associative Castelroussine Vent Solars rend au départ son poids d’humanité, sa charge poétique, son pouvoir d’insurrection. Avec « Partir » et après « Possibles » le titre de son premier roman sans jeu de mots , elle compose un récit lumineux, incarné, traversé par la fuite et le recommencement, la douleur et la douceur, l’errance et l’affirmation de soi. À rebours des discours sécuritaires et des imaginaires victimaires, elle tisse une trajectoire queer, féminine, post-coloniale, qui lie l’intime à l’histoire et le corps à la géographie.
L’exil pour renaître : une clé sans porte comme viatique
Le roman s’ouvre dans le tumulte d’Alep, cité éventrée par les bombes, devenue l’épicentre d’un monde en ruine. Pourtant, la narratrice n’emporte avec elle ni valise ni talisman, mais une clé sans porte. « Il me reste une clé, la clé de chez moi, une clé sans porte. C’est le seul souvenir, une clé inutile… la preuve que la porte a existé », écrit-elle page 33. Cet objet dérisoire et poignant, vestige d’un passé effondré, condense à lui seul toute la philosophie de l’exil dans Partir. Il ne s’agit pas seulement de fuir, mais de quitter avec un fragment du réel, un éclat de la maison, comme on emporte un mot de passe muet, une trace ténue de ce qui fut.
Ce motif rejoint toute une tradition littéraire où le départ s’accompagne d’un geste d’allègement — une forme de dépossession volontaire ou subie. On songe ici à Kafka, dont les personnages, comme K. dans Le Château, se heurtent à des portes fermées, à des clefs sans usage, symboles d’un monde bureaucratisé, absurde, impraticable. Mais chez Valérie Baud, cette clef ne condamne pas, elle ouvre sur l’imaginaire, sur le rêve d’être un oiseau : « Je pourrais être n’importe qui, être un oiseau m’irait mieux. » Ce glissement vers l’animal, la métamorphose, évoque Ovide, mais aussi Virginia Woolf dans Orlando, où l’identité devient fluide et mobile, insaisissable.
La clef symbolise ce que Walter Benjamin appelait un fragment dialectique : un objet minuscule chargé d’histoire, capable de révéler un monde englouti. Elle est à la fois preuve d’une perte et promesse d’un ailleurs, trace d’une porte disparue et appel à en forger de nouvelles. Par contraste avec la pesanteur de l’avoir, du patrimoine et des « affaires à abandonner », la narratrice incarne ici une forme d’éthique du dépouillement, proche de celle que Simone Weil esquissait dans La Pesanteur et la grâce. La perte matérielle est la condition d’une grâce nouvelle, celle de pouvoir enfin « se passer de tout ».
En ce sens, la clef sans porte n’est pas un symbole de misère, mais de possibles ,comme un écho au premier roman de Valérie Baud. C’est un objet littéraire et poétique total, qui permet au roman de s’inscrire dans une tradition de l’exil non pas seulement géographique, mais ontologique. Partir, c’est aussi devenir une autre, et peut-être enfin, comme dans les poèmes de Mahmoud Darwich, se rapprocher de l’oiseau, figure de l’exilé par excellence : « Je ne suis d’aucun pays / je suis un oiseau des deux rives. »
Une géopolitique de l’intime
À rebours des récits doloristes, la narratrice de « Partir » ne se contente pas de survivre : elle pense, elle crée, elle aime. Artiste queer, elle inscrit son corps et son désir dans le paysage. « Peut-être que les plus belles histoires sont celles qui sont trop courtes pour faner. » Cette phrase, suspendue comme un haïku, dit à la fois la fugacité de l’amour et son intensité. On pense à Giovanni’s Room de Baldwin ou à La Vie rêvée des plantes de Lee Seung-U, où l’intime devient politique, et l’amour, géopolitique.
Le pays d’accueil, en Amérique du Sud, n’est jamais nommé, mais il est décrit comme un espace d’ouverture législative et symbolique : « L’Argentine historiquement est le premier pays d’Amérique latine à faire disparaître la mention mari et femme du Code civil. » (Hélas en 2019 quand Valérie Baud débute l’écriture de son roman l’Argentine ne se démarque plus autant par cette ouverture. Le pays est à la main depuis l’élection de 2023 et jusqu’à présent d’un gouvernement face auquel les luttes pour les droits des personnes LGBTQI ont repris en réponse à une répression accrue ) . Cette phrase n’est pas une simple anecdote juridique, elle incarne une promesse, celle d’un monde réconcilié avec la pluralité. On retrouve ici l’idéal d’un unus mundus jungien, une utopie de l’unité sans uniformité. La narratrice confie : « Je marche, mais je ne suis pas certaine d’avoir le droit de marcher ici. » Cette phrase, d’apparence anodine, condense toute la précarité existentielle de l’exil : être là sans y être pleinement autorisée, habiter sans posséder, circuler sans s’enraciner.
Une langue insurgée, une poésie de combat
La langue de Valérie Baud est dense, sensorielle, travaillée par le souffle et le silence. « Une odeur maritime s’impose à moi, nouvelle subtilité aérienne que je décrirais comme verte et océane. » Cette phrase, presque synesthésique, rappelle les intuitions de Rimbaud ou de Saint-John Perse, où la mer se mue en un lieu d’élévation sensorielle. Mais c’est aussi un espace politique : l’ailleurs maritime, c’est la promesse d’un monde ouvert.
À l’instar de René Char — « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience » —, Valérie Baud fait de la littérature une forme d’insoumission douce. Elle rejoint les poètes de la résistance, de Mahmoud Darwich à Nazim Hikmet, dont les vers mêlent l’intime à la lutte. Comme ces écrivains, elle ne sépare jamais la beauté de la lucidité, ni l’amour du combat.
Fiction et contre-pouvoir : dessiner l’invisible
« Écrire, c’est comme marcher les yeux bandés. » Cette phrase de la narratrice, à la fois humble et audacieuse, exprime le cœur du projet littéraire de l’autrice: avancer sans certitude, mais avec confiance. On pense ici à l’essai d’Agnès Heller, L’esthétique de la vie quotidienne, où l’art n’est pas un luxe mais une manière d’habiter le monde. Le dessin, omniprésent dans le roman, devient un acte de survie. « Vous avez un sacré coup de crayon », lui dit un réalisateur. Par ce trait, elle reconquiert le réel, elle traduit l’illisible, elle rend visible — comme le voulait Paul Klee : « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. »
Vers une littérature-monde
« Partir » trace une cartographie mouvante, où les liens priment sur les lignes de frontière. « Je marche en confiance. Pourquoi ? Je l’ignore. » Cette phrase, à la fois candide et profonde, rappelle les carnets de Nicolas Bouvier, pour qui le voyage est moins une conquête qu’une métamorphose. L’amour pour Khawla, suspendu dans le non-dit, traverse le texte comme une musique inachevée — à la manière des récits d’Annie Ernaux, ou de Monique Wittig, où le corps lesbien devient acte de rupture et d’affirmation.
Valérie Baud s’inscrit dans cette lignée des écrivains du dehors — Toni Morrison, Nina Bouraoui, Rachid O — dont les personnages ne cherchent pas à convaincre, mais à exister. Le cinéaste Jorge, figure solaire, le résume ainsi : « Il ne filme pas ce qui fait pleurer. Il filme ce qui fait vivre. » Cette phrase contient peut-être la clef du roman : l’art n’est pas ici pour panser ou compenser, mais pour faire advenir.
Une voix politique, charnelle, indocile
« Je suis partie. J’ai fui. J’ai désobéi. » Cette anaphore est un manifeste. En récusant la langue comme assignation, en écrivant dans un français d’adoption — non pas comme langue seconde, mais comme seconde peau — la narratrice rejoint les figures d’Edouard Glissant ou de Bell Hooks, pour qui la langue est toujours un champ de bataille. Valérie Baud ne théorise pas, elle incarne. Elle ne plaide pas, elle vit.
Un voyage littéraire captivant qui célèbre un commencement
« Partir » est tout à la fois un journal d’exil, une lettre d’amour, un chant du départ, un acte de présence. En cela, il rejoint Césaire, pour qui « il y a dans le monde plus de choses à admirer qu’à mépriser ». Un roman qui n’évoque pas seulement la fuite, mais l’invention d’un lieu pour vivre.